










Chers frères et sœurs, bonjour !
Merci, Madame la Rectrice, pour vos paroles. Obrigado. Vous avez dit que nous nous sentons tous « pèlerins ». C’est un beau mot dont la signification mérite d’être méditée. Il signifie littéralement laisser de côté la routine habituelle et se mettre en chemin avec une intention, en se déplaçant « à travers les champs » ou « au-delà de ses frontières », c’est-à-dire hors de sa zone de confort, vers un horizon de sens. Dans le mot « pèlerin », nous voyons se refléter la condition humaine, parce que chacun est appelé à se confronter à de grandes questions qui n’ont pas de réponse, une réponse simpliste ou immédiate, mais qui invitent à accomplir un voyage, à se dépasser, à aller plus loin. C’est un processus qu’un universitaire comprend bien, car la science naît ainsi. Et ainsi grandit également la recherche spirituelle. Être pèlerin, c’est marcher vers un but ou chercher un but. Il y a toujours le danger de marcher dans un labyrinthe, où il n’y a pas d’objectif. Et même pas de sortie. Méfions-nous des formules préfabriquées – ce sont des labyrinthes – méfions-nous des réponses qui semblent à portée de main, tirées de la manche comme des cartes à jouer truquées ; méfions-nous de ces propositions qui semblent tout donner sans rien demander. Méfions-nous! Cette méfiance est une arme pour pouvoir avancer et ne pas continuer à tourner en rond. Dans une parabole de Jésus, trouve la perle de grande valeur celui qui la cherche avec intelligence et avec un esprit d’initiative, et il donne tout, il risque tout ce qu’il a pour l’avoir (cf. Mt 13, 45-46). Chercher et risquer : voilà les deux verbes du pèlerin. Chercher et risquer.
Pessoa a dit, de manière tourmentée mais correcte, qu’ « être insatisfait, c’est être homme » (Mensagem, O Quinto Império). N’ayons pas peur de nous sentir inquiets, de penser que ce que nous faisons ne suffit pas. Être insatisfait, dans ce sens et dans une juste mesure, est un bon antidote contre la présomption d’autosuffisance et contre le narcissisme. L’imperfection caractérise notre condition de chercheurs et de pèlerins, comme dit Jésus, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde (cf. Jn 17, 16). Nous marchons « vers ». Nous sommes appelés à quelque chose de plus, à un décollage sans lequel il n’y a pas de vol. Ne nous alarmons pas alors si nous nous trouvons assoiffés de l’intérieur, inquiets, inachevés, avides de sens et d’avenir, com saudades do futuro ! Et ici, avec la saudade de l’avenir, n’oubliez pas de garder vivante la mémoire de l’avenir. Ne soyons pas malades, soyons vivants ! Inquiétons-nous plutôt lorsque nous sommes prêts à remplacer la route à faire par un quelconque point de rafraîchissement, pourvu qu’il nous donne l’illusion du confort ; lorsque nous remplaçons les visages par les écrans, le réel par le virtuel ; lorsque, à la place des questions qui déchirent, nous préférons les réponses faciles qui anesthésient. Et nous pouvons les trouver dans n’importe quel manuel sur les relations sociales, comment bien se comporter. Les réponses faciles anesthésient.
Chers amis, permettez-moi de vous dire : cherchez et risquez. En ce moment historique, les défis sont énormes, les gémissements douloureux – nous vivons une troisième guerre mondiale par morceaux –, mais nous embrassons le risque de penser que nous ne sommes pas en agonie, mais en accouchement ; non pas à la fin, mais au début d’un grand spectacle. Il faut du courage pour penser cela. Soyez donc des protagonistes d’une « nouvelle chorégraphie » qui mette au centre la personne humaine, soyez chorégraphes de la danse de la vie. Les paroles de Madame la Rectrice ont été pour moi inspirantes, en particulier quand elle a dit que « l’université n’existe pas pour se préserver comme institution, mais pour répondre avec courage aux défis du présent et de l’avenir ». L’auto-préservation est une tentation, c’est un réflexe conditionné par la peur qui fait regarder l’existence de manière déformée. Si les graines se préservaient, elles gaspilleraient complètement leur puissance génératrice et elles nous condamneraient à la faim ; si les hivers se préservaient, il n’y aurait pas l’émerveillement du printemps. Ayez donc le courage de remplacer les peurs par des rêves. Remplacez les peurs par les rêves : ne soyez pas administrateurs de peurs, mais des entrepreneurs de rêves !
Ce serait un gaspillage de penser à une université engagée à former les nouvelles générations uniquement pour perpétuer le système élitiste et inégal actuel du monde, où l’enseignement supérieur reste un privilège pour quelques-uns. Si la connaissance n’est pas accueillie comme une responsabilité, elle devient stérile. Si celui qui a reçu un enseignement supérieur (qui reste aujourd’hui, au Portugal et dans le monde, un privilège) ne s’efforce pas de restituer ce dont il a bénéficié, il n’a pas compris tout à fait ce qui lui a été offert. J’aime penser au Livre de la Genèse ; les premières questions que Dieu pose à l’homme sont : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9) et « Où est ton frère ? » (Gn 4, 9). Ça nous fera du bien de nous demander, demandons-nous : Où suis-je ? Suis-je enfermé dans ma bulle ou est-ce que je cours le risque de sortir de mes sécurités pour devenir un chrétien pratiquant, un artisan de justice, un artisan de beauté ? Et encore : Où est mon frère ? Des expériences de service fraternel comme la Missão Pais et beaucoup d’autres qui naissent du milieu académique devraient être considérées comme indispensables pour ceux qui passent par une université. Le diplôme ne doit en effet pas être considéré seulement comme une permission pour construire le bien-être personnel, non, mais comme un mandat pour se consacrer à une société plus juste, une société plus inclusive, c’est-à-dire plus avancée. On m’a dit qu’une de vos grandes poètes, Sophia de Mello Breyner Andresen, dans une interview qui est une sorte de testament, à la question : « Qu’aimeriez-vous voir réalisé au Portugal en ce nouveau siècle ? », a répondu sans hésiter : « Je voudrais voir la justice sociale réalisée, la réduction du fossé entre riches et pauvres » (Entrevista de Joaci Oliveira, in Cidade Nova, nº 3/2001). Je vous adresse en retour cette question. Vous, chers étudiants, pèlerins du savoir, que voulez-vous voir réalisé au Portugal et dans le monde ? Quels changements, quelle transformation ? Et comment l’université, surtout l’université catholique, peut-elle y contribuer ?
Beatriz, Mahoor, Mariana, Tomás, je vous remercie pour vos témoignages. Ils ont tous un ton d’espérance, une charge d’enthousiasme réaliste, sans plaintes ni fuites en avant idéalistes. Vous voulez être protagonistes, « protagonistes du changement », comme l’a dit Mariana. En vous écoutant, j’ai pensé à une phrase qui vous est peut-être familière, de l’écrivain José de Almada Negreiros : « J’ai rêvé d’un pays où tous parvenaient à être maîtres » (A Invenção do Dia Claro). De même, cet ancien qui vous parle – je suis vieux maintenant –, rêve que votre génération devienne une génération de maîtres. Maîtres d’humanité. Maîtres de compassion. Maîtres de nouvelles opportunités pour la planète et ses habitants. Maîtres d’espérance. Et des maîtres qui défendent la vie de la planète, menacée en ce moment par une grave destruction écologique.
Comme certains d’entre vous l’ont souligné, nous devons reconnaître l’urgence dramatique de prendre soin de la maison commune. Cependant, cela ne peut se faire sans une conversion du cœur et un changement de la vision anthropologique qui est à la base de l’économie et de la politique. On ne peut se contenter de simples mesures palliatives ou de compromis timides et ambigus, car, « les justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement » (Lett. enc. Laudato si’, n. 194). N’oubliez pas ceci. Les termes moyens ne sont qu’un petit retard dans l’effondrement. Il s’agit au contraire de prendre en charge ce qui, malheureusement, continue à être reporté : la nécessité de redéfinir ce que nous appelons progrès et évolution. Parce que, au nom du progrès, on a fait trop de chemin à reculons. Étudiez bien ce que je vous dis. Au nom du progrès, la voie est ouverte à une grande régression. Vous êtes la génération qui peut relever ce défi : vous avez les outils scientifiques et technologiques les plus avancés mais, s’il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de visions partielles. N’oubliez pas que nous avons besoin d’une écologie intégrale, d’écouter la souffrance de la planète en même temps que celle des pauvres ; de mettre le drame de la désertification en parallèle avec celui des réfugiés ; le thème des migrations avec celui de la dénatalité ; de nous occuper de la dimension matérielle de la vie dans une dimension spirituelle. Pas des polarisations, mais des visions d’ensemble.
Merci, Tomás, pour avoir dit qu’ « une authentique écologie intégrale sans Dieu n’est pas possible, qu’il ne peut y avoir d’avenir dans un monde sans Dieu ». Je voudrais vous dire : rendez la foi crédible à travers les choix. Car si la foi n’engendre pas des styles de vie convaincants, elle ne fait pas lever la pâte du monde. Il ne suffit pas qu’un chrétien soit convaincu, il doit être convaincant ; nos actions sont appelées à refléter la beauté, joyeuse et à la fois radicale, de l’Évangile. En outre, le christianisme ne peut pas être habité comme une forteresse entourée de murs, qui élève des bastions contre le monde. C’est pourquoi j’ai trouvé émouvant le témoignage de Beatriz, quand elle a dit qu’ « à partir du champ de la culture » elle se sent appelée à vivre les Béatitudes. À chaque époque, l’une des tâches les plus importantes pour les chrétiens est de retrouver le sens de l’incarnation. Sans l’incarnation, le christianisme devient une idéologie et la tentation des idéologies chrétiennes, entre guillemets, est très actuelle. C’est l’incarnation qui permet d’être émerveillé de la beauté que le Christ révèle à travers chaque frère et sœur, chaque homme et chaque femme.
À ce propos, il est intéressant que, dans votre nouvelle chaire consacrée à l’ « Économie de François », vous ayez ajouté la figure de Claire. En effet, la contribution des femmes est indispensable. Dans l’inconscient collectif, combien de fois on pense que les femmes sont de deuxième catégorie, qu’elles sont des réserves, qu’elles ne jouent pas en tant que titulaires. Cela existe dans l’inconscient collectif. La contribution féminine est indispensable. On voit d’ailleurs dans la Bible comment l’économie de la famille est en grande partie entre les mains de la femme. C’est elle la véritable « régente » de la maison, avec une sagesse qui n’a pas pour but exclusif le profit, mais le soin, la coexistence, le bien-être physique et spirituel de chacun, et aussi le partage avec les pauvres et les étrangers. Et il est passionnant d’aborder les études économiques dans cette perspective : avec le but de redonner à l’économie la dignité qui lui revient, afin qu’elle ne soit pas la proie du marché sauvage et de la spéculation.
L’initiative du Pacte Éducatif Mondial, et les sept principes qui en forment l’architecture, comprennent beaucoup de ces thèmes, du soin de la maison commune à la pleine participation des femmes, jusqu’à la nécessité de trouver de nouvelles façons de comprendre l’économie, la politique, la croissance et le progrès. Je vous invite à étudier ce Pacte Éducatif Mondial, vous en passionner. L’un des points qu’il traite est l’éducation à l’accueil et à l’inclusion. Et nous ne pouvons pas feindre de ne pas avoir entendu les paroles de Jésus au chapitre 25 de Matthieu : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (v. 35). J’ai écouté avec émotion le témoignage de Mahoor, quand elle a évoqué ce que signifie vivre avec « le sentiment constant d’absence d’un foyer, d’une famille, d’amis […], d’être restée sans maison, sans université, sans argent […], fatiguée et épuisée et abattue par la douleur et les pertes ». Elle nous a dit qu’elle avait retrouvé l’espoir parce que quelqu’un avait cru en l’impact transformant de la culture de la rencontre. Chaque fois que quelqu’un pratique un geste d’hospitalité, il provoque une transformation.
Chers amis, je suis très heureux de vous voir comme une communauté éducative vivante, ouverte à la réalité, et conscients que l’Évangile qui ne sert pas d’ornement mais qui anime les parties et l’ensemble. Je sais que votre parcours comprend différents domaines : études, amitié, service social, responsabilité civile et politique, soin de la maison commune, expressions artistiques… Être une université catholique signifie d’abord ceci : que chaque élément est en relation avec le tout et que le tout se retrouve dans les parties. Ainsi, en acquérant des compétences scientifiques, on mûrit en tant que personne dans la connaissance de soi et dans le discernement de sa propre voie. Voie oui, labyrinthe non. Alors, continuez ! Une tradition médiévale raconte que lorsque les pèlerins du chemin de Saint Jacques se croisaient, l’un saluait l’autre en s’exclamant « Ultreia » et l’autre répondait « et Suseia ». Ce sont des expressions d’encouragement à continuer la recherche et le risque du chemin, en nous disant mutuellement : « Allez, courage, va de l’avant ! ». C’est ce que je souhaite aussi à vous tous, de tout mon cœur. Merci.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Chers frères et sœurs, bonjour !
Sur notre chemin à la redécouverte de notre passion pour l’annonce de l’Evangile, pour voir comment le zèle apostolique, cette passion pour annoncer l’Evangile s’est développée dans l’histoire de l’Eglise, sur ce chemin, nous nous tournons aujourd’hui vers les Amériques. Ici, l’évangélisation a une source toujours vivante: Guadalupe. C’est une source vivante. Les Mexicains sont contents! Bien sûr, l’Evangile y était déjà parvenu avant ces apparitions, mais il avait malheureusement été aussi accompagné d’intérêts mondains. Au lieu du chemin de l’inculturation, on a trop souvent emprunté le raccourci de la transplantation et de l’imposition de modèles pré-constitués — européens, par exemple —, sans respect pour les peuples autochtones. La Vierge de Guadalupe, en revanche, apparaît vêtue des habits des autochtones, parle leur langue, accueille et aime la culture locale: Marie est Mère et sous son manteau chaque enfant trouve sa place. En Elle, Dieu s’est fait chair et, à travers Marie, il continue à s’incarner dans la vie des peuples. La Vierge, en effet, annonce Dieu dans la langue la plus appropriée, c’est-à-dire la langue maternelle. Oui, l’Evangile est transmis dans la langue maternelle. Et à nous aussi la Vierge parle dans une langue maternelle, celle que nous connaissons bien. Oui, l’Evangile se transmet dans la langue maternelle. Et je voudrais dire merci aux nombreuses mères et aux nombreuses grands-mères qui le transmettent à leurs enfants et petits-enfants: la foi passe avec la vie, c’est pourquoi les mères et les grands-mères sont les premières annonciatrices. Un applaudissement aux mères et aux grands-mères! Et l’Evangile se communique, comme le montre Marie, dans la simplicité: la Vierge choisit toujours des personnes simples, sur la colline de Tepeyac au Mexique comme à Lourdes et à Fatima: en leur parlant, elle parle à chacun, dans un langage adapté à tous, dans un langage compréhensible, comme celui de Jésus.
Arrêtons-nous donc sur le témoignage de saint Juan Diego, qui est le messager, c’est le garçon, c’est l’au-tochtone qui a reçu la révélation de Marie: le messager de la Vierge de Guadalupe. C’était une personne humble, un Indien du peuple: Sur lui, s’est posé le regard de Dieu, qui aime accomplir des miracles à travers les petits. Juan Diego était venu à la foi déjà adulte et marié. En décembre 1531, il avait environ 55 ans. En chemin, il aperçoit sur une colline la Mère de Dieu, qui l’appelle tendrement, et comment la Vierge l’appelle-t-elle? «Mon petit fils bien-aimé Juanito» (Nican Mopohua, 23). Elle l’envoie ensuite auprès de l’évêque pour lui demander de construire un temple à l’endroit où elle était apparue. Juan Diego, simple et disponible, y va avec la générosité de son cœur pur, mais il doit attendre longtemps. Il parle enfin à l’évêque, mais on ne le croit pas. Parfois, nous évêques… Il rencontre à nouveau la Vierge, qui le console et lui demande d’essayer à nouveau. L’indien retourne auprès de l’évêque et, non sans grande difficulté, le rencontre, mais ce dernier, après l’avoir écouté, le renvoie et envoie des hommes le suivre. Voilà la difficulté, l’épreuve de l’annonce: malgré le zèle, arrivent les imprévus, parfois de l’Eglise elle-même. Pour annoncer, en effet, il ne suffit pas de témoigner du bien, il faut pouvoir supporter le mal. N’oublions pas cela: c’est très important pour annoncer l’Evangile, il ne suffit pas de témoigner le bien, mais il faut savoir supporter le mal. Un chrétien fait le bien, mais il supporte le mal. Les deux choses vont ensemble, la vie est ainsi. Aujourd’hui aussi, dans de nombreux endroits, l’inculturation de l’Evangile et l’évangélisation des cultures exigent persévérance et patience, il ne faut pas craindre les conflits, ni perdre confiance. Je pense à un pays où les chrétiens sont persécutés, parce qu’ils sont chrétiens et ne peuvent pas pratiquer leur religion bien et dans la paix. Juan Diego, découragé, parce que l’évêque le ren-voyait, demande à la Vierge de le dispenser et de nommer quelqu’un de plus estimé et plus capable que lui, mais il est invité à persévérer. Il y a toujours le risque d’une certaine capitulation dans l’annonce: une chose ne va pas et on fait marche arrière, en se décourageant et en se réfugiant peut-être dans ses propres certitudes, dans les petits groupes et dans quelques dévotions intimistes. La Vierge, au contraire, tout en nous consolant, nous fait avancer et ainsi, nous fait grandir, comme une bonne mère qui, tout en suivant les pas de son fils, le lance dans les défis du monde.
Juan Diego, ainsi encouragé, retourne auprès de l’évêque qui lui demande un signe. La Vierge le lui promet et le réconforte par ces mots: «Que ton visage et ton cœur ne se troublent pas: […] Ne suis-je pas ici, ta mère?» (ibid., 118-119). C’est beau cela, très souvent, comme nous sommes en proie au découragement, à la tristesse, aux difficultés, la Vierge nous le dit à nous aussi, dans le cœur: «Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère?». Toujours proche pour nous réconforter, et nous donner la force d’aller de l’avant. Elle lui demande ensuite d’aller cueillir des fleurs au sommet de la colline aride. C’est l’hiver, mais Juan Diego en trouve de très belles, les met dans son manteau et les offre à la Mère de Dieu, qui l’invite à les apporter à l’évêque comme preuve. Il s’y rend, attend patiemment son tour et finalement, en présence de l’évêque, ouvre sa tilma — qui est ce qu’utilisaient les autochtones pour se couvrir — il ouvre sa tilma en montrant les fleurs et voici: sur le tissu du manteau apparaît l’image de la Madone, la Vierge extraordinaire et vivante que nous connaissons tous, dans les yeux de laquelle les protagonistes de l’époque se reflètent encore. Voici la surprise de Dieu: quand il y a disponibilité et quand il y a obéissance, Il peut accomplir quelque chose d’inattendu, en des temps et des manières que nous ne pouvons pas prévoir. C’est ainsi que le sanctuaire demandé par la Vierge a été construit et qu’aujourd’hui, on peut le visiter.
Juan Diego quitte tout et, avec la permission de l’évêque, consacre sa vie au sanctuaire. Il accueille les pèlerins et les évangélise. C’est ce qui a lieu dans les sanctuaires mariaux, destinations de pèlerinage et lieux d’annonce, où chacun se sent chez soi — parce que c’est la maison de la mère, c’est la maison de la mère — et éprouve la nostalgie de sa maison, c’est-à-dire la nostalgie du lieu où se trouve la Mère, le Ciel. Là, la foi est accueillie de manière simple, la foi est accueillie de façon authentique, de façon populaire, et la Vierge, comme elle l’a dit à Juan Diego, écoute nos pleurs et guérit nos peines (cf. ibid., 32). Apprenons cela: quand il y a des difficultés dans la vie, allons voir la Mère; et quand la vie est heureuse, allons voir la Mère pour partager cela également. Nous avons besoin de nous rendre dans ces oasis de consolation et de miséricorde, où la foi s’exprime dans la langue maternelle, où nous déposons les difficultés de la vie dans les bras de la Vierge et où nous retournons à la vie avec la paix dans le cœur, peut-être avec la paix des enfants.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
DISCOURS DU SAINT-PÈRE
Dimanche 3 septembre 2023
Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs !
Permettez-moi de m’adresser à vous comme frère dans la foi avec les croyants en Christ et comme frère pour vous tous, au nom de la quête religieuse commune et de l’appartenance à la même humanité. L’humanité, dans son aspiration religieuse, peut être comparée à une communauté de voyageurs marchant sur la terre avec le regard tourné vers le ciel. À cet égard, ce qu’un croyant, venu de loin, a dit de la Mongolie est significatif : il a écrit qu’il a voyagé « sans rien voir d’autre que le ciel et la terre » (Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia, XIII/3, Milano 2014, 63). Le ciel, si limpide, si bleu, étreint ici la terre vaste et imposante, évoquant les deux dimensions fondamentales de la vie humaine : la dimension terrestre, faite de relations avec les autres, et la dimension céleste, faite de la recherche de l’Autre, qui nous transcende. La Mongolie rappelle en somme le besoin, pour nous tous, pèlerins et voyageurs, de tourner le regard vers le haut pour trouver le cap de la marche sur la terre.
Je suis donc heureux d’être avec vous en ce moment important de rencontre. Je remercie chaleureusement chacun et chacune pour sa présence et pour chaque intervention qui a enrichi notre réflexion commune. Le fait d’être ensemble dans le même lieu est déjà un message : les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société. Si les responsables des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres, ils contribueraient certainement de manière décisive à mettre fin aux conflits qui continuent à faire souffrir tant de peuples.
Le bien-aimé peuple mongol, qui peut se targuer d’une histoire de coexistence entre les membres de diverses traditions religieuses, nous donne l’occasion de nous réunir pour apprendre à nous connaître et à nous enrichir mutuellement. Il est bon de rappeler cette expérience vertueuse de l’ancienne capitale impériale, Kharakorum, dans laquelle se trouvaient des lieux de culte appartenant à différentes croyances, témoignant d’une harmonie louable. Harmonie : je voudrais insister sur ce mot au goût typiquement asiatique. Elle est cette relation particulière qui se crée entre des réalités différentes, sans les superposer ni les homologuer, mais dans le respect des différences et au profit de la vie commune. Je me demande : qui, plus que les croyants, est appelé à travailler pour l’harmonie de tous ?
Frères, sœurs, la valeur sociale de notre religiosité se mesure à la manière dont nous parvenons à nous harmoniser avec les autres pèlerins sur terre, et à la manière dont nous parvenons à répandre l’harmonie là où nous vivons. Toute vie humaine, en effet, et à plus forte raison toute religion, est appelée à « se mesurer » en fonction de l’altruisme : non pas un altruisme abstrait, mais concret, se traduisant par la recherche de l’autre et la collaboration généreuse avec l’autre, parce que « le sage se réjouit dans le don, et c’est par là seulement qu’il devient heureux » (The Dhammapada : The Buddha’s Path of Wisdom, Sri Lanka 1985, n. 177 ; cf. les paroles de Jésus rapportées dans Ac 20, 35). Une prière, inspirée par François d’Assise, récite : « Là où il y a de la haine, que je mette l’amour, là où il y a l’offense, que je mette le pardon, là où il y a la discorde, que je mette l’union ». L’altruisme construit l’harmonie et là où il y a l’harmonie, il y a l’entente, il y a la prospérité, il y a la beauté. En effet, harmonie est peut-être le synonyme le plus approprié de beauté. En revanche, la fermeture, l’imposition unilatérale, le fondamentalisme et la contrainte idéologique ruinent la fraternité, alimentent les tensions et sapent la paix. La beauté de la vie est le fruit de l’harmonie : elle est communautaire, elle grandit avec la gentillesse, l’écoute et l’humilité. Et c’est le cœur pur qui la saisit, car « la vraie beauté, après tout, réside dans la pureté du cœur » (M.K. Gandhi, Il mio credo, il mio pensiero, Roma 2019, 94).
Les religions sont appelées à offrir au monde cette harmonie que le progrès technique à lui seul ne peut assurer, car, en visant la dimension terrestre, horizontale de l’homme, il risque d’oublier le ciel pour lequel nous sommes faits. Sœurs et frères, nous sommes ici aujourd’hui en tant qu’humbles héritiers d’anciennes écoles de sagesse. En nous rencontrant, nous nous engageons à partager tout le bien que nous avons reçu, afin d’enrichir une humanité qui, dans son cheminement, est souvent désorientée par des recherches à court terme du profit et du bien-être. Elle est souvent incapable de trouver le fil conducteur : tournée uniquement vers les intérêts terrestres, elle finit par ruiner la terre elle-même, confondant progrès et régression, comme le montrent tant d’injustices, tant de conflits, tant de dévastations environnementales, tant de persécutions, tant de rejet de la vie humaine.
L’Asie a beaucoup à offrir à cet égard et la Mongolie, qui se trouve au cœur de ce continent, conserve un grand patrimoine de sagesse, que les religions répandues ici ont contribué à créer et que je voudrais inviter chacun à découvrir et à valoriser. Je ne ferai qu’évoquer, sans les approfondir, dix aspects de cet héritage de sagesse. Dix aspects : le bon rapport avec la tradition, malgré les tentations consuméristes ; le respect des anciens et des ancêtres – combien avons-nous besoin aujourd’hui d’une alliance générationnelle entre eux et les plus jeunes, de dialogue entre les grands-parents et les petits-enfants ! Et puis, le respect de l’environnement, notre maison commune, une autre nécessité d’une actualité brûlante : nous sommes en danger. Et encore : la valeur du silence et de la vie intérieure, antidote spirituel à tant de maux du monde d’aujourd’hui. Ensuite, un sens sain de la sobriété ; la valeur de l’accueil ; la capacité de résister à l’attachement aux choses ; la solidarité, qui découle de la culture des liens entre les personnes ; l’appréciation de la simplicité. Et, enfin, un certain pragmatisme existentiel, qui tend à rechercher avec ténacité le bien de l’individu et de la communauté. Ces dix aspects sont là quelques éléments du patrimoine de sagesse que ce pays peut offrir au monde.
À propos de vos traditions, j’ai déjà dit combien, en préparant ce voyage, j’avais été fasciné par les habitations traditionnelles à travers lesquelles le peuple mongol révèle une sagesse sédimentée par des millénaires d’histoire. La ger constitue en effet un espace humain : en son sein se déroule la vie de la famille, c’est un lieu de convivialité amicale, de rencontre et de dialogue où, même lorsqu’on est nombreux, on sait faire de la place à quelqu’un d’autre. Et puis c’est un point de repère concret, facilement identifiable dans les vastes étendues du territoire mongol ; c’est un motif d’espérance pour ceux qui se sont égarés : s’il y a une ger, il y a la vie. On la trouve toujours ouverte, prête à accueillir l’ami, mais aussi le voyageur et même l’étranger, pour lui offrir un thé fumant qui fait reprendre des forces dans le froid de l’hiver ou un lait fermenté frais qui apporte un rafraîchissement durant les chaudes journées d’été. C’est aussi l’expérience des missionnaires catholiques, provenant d’autres pays, qui sont accueillis ici comme pèlerins et hôtes, et qui entrent sur la pointe des pieds dans ce monde culturel, pour offrir l’humble témoignage de l’Évangile de Jésus-Christ.
Mais, en plus de l’espace humain, la ger évoque l’essentielle ouverture au divin. La dimension spirituelle de cette habitation est représentée par son ouverture vers le haut, avec un seul point d’où la lumière entre, sous la forme d’une lucarne en tranches. L’intérieur devient ainsi un grand cadran solaire, dans lequel la lumière et l’ombre se succèdent, marquant les heures du jour et de la nuit. Il y a là une belle leçon à tirer : le sens du temps qui passe vient d’en haut, et non du simple flux des activités terrestres. Ainsi, à certaines périodes de l’année, le rayon qui pénètre d’en haut illumine l’autel domestique, rappelant la primauté de la vie spirituelle. La coexistence humaine qui se déroule dans l’espace circulaire est ainsi constamment renvoyée à sa vocation verticale, transcendante et spirituelle.
L’humanité réconciliée et prospère, que nous contribuons à promouvoir en tant que représentants de différentes religions, est symboliquement représentée par cette convivialité harmonieuse ouverte à la transcendance, où l’engagement pour la justice et la paix trouve inspiration et fondement dans la relation avec le divin. Ici, chers sœurs et frères, notre responsabilité est grande, surtout en cette heure de l’histoire, car notre comportement est appelé à confirmer dans les faits les enseignements que nous professons ; il ne peut pas les contredire, en devenant un motif de scandale. Aucune confusion donc entre croyance et violence, entre sacré et imposition, entre parcours religieux et sectarisme. Que la mémoire des souffrances endurées dans le passé – je pense en particulier aux communautés bouddhistes – donne la force de transformer les sombres blessures en sources de lumière, l’absurdité de la violence en sagesse de vie, le mal qui détruit en bien qui construit. Qu’il en soit ainsi pour nous, disciples enthousiastes de nos maîtres spirituels respectifs et serviteurs consciencieux de leurs enseignements, disposés à offrir la beauté à ceux que nous accompagnons, en compagnons de route amicaux. Cela est vrai, parce que dans les sociétés pluralistes qui croient aux valeurs démocratiques, comme la Mongolie, toute institution religieuse, dûment reconnue par l’autorité civile, a le devoir et en premier lieu le droit d’offrir ce qu’elle est et ce qu’elle croit, dans le respect de la conscience d’autrui et avec pour objectif le plus grand bien de tous.
En ce sens, je voudrais vous confirmer que l’Église catholique veut marcher dans cette voie, en croyant fermement au dialogue œcuménique, au dialogue interreligieux et au dialogue culturel. Sa foi est fondée sur le dialogue éternel entre Dieu et l’humanité, incarné dans la personne de Jésus-Christ. Avec humilité et dans l’esprit de service qui a animé la vie du Maître, venu dans le monde non pas « pour être servi, mais pour servir » (Mc 10, 45), l’Église aujourd’hui offre le trésor qu’elle a reçu à toute personne et à toute culture, en restant dans une attitude d’ouverture et d’écoute de ce que les autres traditions religieuses ont à offrir. Le dialogue, en effet, n’est pas antithétique à l’annonce : il n’aplatit pas les différences, mais aide à les comprendre, les préserve dans leur originalité et leur permet de se confronter pour un enrichissement franc et réciproque. Ainsi, on peut trouver dans l’humanité bénie par le Ciel la clé pour marcher sur la terre. Frères et sœurs, nous avons une origine commune, qui confère à tous la même dignité, et nous avons un chemin commun, que nous ne pouvons parcourir qu’ensemble, en demeurant sous le même ciel qui nous enveloppe et nous illumine.
Frères et sœurs, notre présence ici aujourd’hui est signe qu’espérer est possible. Espérer est possible. Dans un monde déchiré par les conflits et les discordes, cela pourrait sembler utopique ; pourtant, les plus grandes entreprises commencent dans la discrétion, presque imperceptibles. Le grand arbre naît de la petite graine, enfoui dans la terre. Et si « le parfum des fleurs ne se répand que dans la direction du vent, le parfum de ceux qui vivent selon la vertu se répand dans toutes les directions » (cf. The Dhammapada, n. 54). Faisons fleurir cette certitude que nos efforts communs pour dialoguer et construire un monde meilleur ne sont pas vains. Cultivons l’espérance. Comme l’a dit un philosophe : « Chacun fut grand selon ce qu’il a espéré. L’un fut grand en espérant le possible, un autre en espérant l’éternel, mais celui qui espéra l’impossible fut le plus grand de tous » (S.A. Kierkegaard, Crainte et tremblement, Milan 2021, 16). Que les prières que nous élevons vers le ciel et la fraternité que nous vivons sur la terre nourrissent l’espérance ; qu’elles soient le témoignage simple et crédible de notre religiosité, de notre marche ensemble avec le regard fixé vers le haut, de notre façon d’habiter le monde en harmonie – n’oublions pas le mot « harmonie » – en tant que pèlerins appelés à garder l’atmosphère de la maison, pour tous. Merci.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
IPSE est un groupe de louange qui s’est lancé récemment à Angers. Découvrez leur titre For You are with me / Car Tu es avec moi.
Abraham
La promesse
Cette vidéo fait partie du parcours « Héritiers du Sacré-Coeur »
Coeur de Jésus, mystère du verbe incarné
Coeur de Jésus, amour répandu dans nos coeurs par l’Esprit-Saint
Cette vidéo fait partie du parcours « Héritiers du Sacré-Coeur »
« L’amour de Dieu enflamme nos âmes pour que nous le portions aux autres. C’est tout l’Esprit de la Pentecôte : une Effusion de l’Esprit qui doit continuer jusqu’à l’Avènement de Notre Seul Seigneur et Maître et Ami. Le Christianisme c’est la joie. En dehors de la joie, on n’est pas dans la Vérité, car on n’est pas dans l’Amour, n’est-ce pas ». (Pierre Goursat 1972)
« A la grotte de Lourdes, (…) nous avons prié avec Marie. Et tout enveloppés de sa présence nous avons reçu une effusion nouvelle de l’Esprit : grâces de conversion plus radicale, grâces d’humilité, de prière, de compassion, grâces aussi de « oui » plus généreux dans l’engagement. » (Pierre Goursat- IEV- juillet 1976)

« Le parfait ami… » vie de St Claude
Episode 15 : La retraite à Londres



Catéchèse du Saint-Père préparée pour l’Audience générale du 9 avril 2025
Mercredi 9 avril 2025
Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, nous nous penchons sur une autre rencontre de Jésus relatée dans les Évangiles. Cette fois-ci, la personne rencontrée n’a pas de nom. L’évangéliste Marc la présente simplement comme « un homme » (10,17). Il s’agit d’un homme qui depuis sa jeunesse a respecté les commandements, mais qui, malgré cela, n’a pas encore trouvé le sens de sa vie. Il le cherche. C’est peut-être quelqu’un qui n’a pas pris de décision jusqu’au bout, malgré l’apparence de personne engagée. Au-delà des choses que nous faisons, des sacrifices ou des succès, ce qui compte vraiment pour être heureux, c’est ce que nous portons dans notre cœur. Si un navire doit prendre la mer et quitter le port pour naviguer en haute mer, il a beau être merveilleux, avec un équipage exceptionnel, s’il ne tire pas sur le lest et les ancres qui le retiennent, il n’avancera jamais. Cet homme s’est construit un navire de luxe, mais il est resté au port !
Alors que Jésus poursuit son chemin, cet homme court vers lui, s’agenouille devant lui et lui demande : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» (v. 17). Remarquez les verbes : « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ». Puisque l’observation de la Loi ne lui a pas donné le bonheur et la sécurité d’être sauvé, il se tourne vers le Maître Jésus. Ce qui est frappant, c’est que cet homme ne connaît pas le vocabulaire de la gratuité ! Tout lui semble dû. Tout est un devoir. La vie éternelle est pour lui un héritage, quelque chose qui s’obtient de droit, par le respect méticuleux des engagements. Mais dans une vie vécue ainsi, même si c’est certainement pour le bien, quelle place peut avoir l’amour ?
Comme toujours, Jésus va au-delà de l’apparence. Alors que cet homme met en avant son bel curriculum, Jésus va plus loin et regarde à l’intérieur. Le verbe utilisé par Marc est très significatif : « posant son regard sur lui » (v. 21). C’est précisément parce que Jésus regarde à l’intérieur de chacun de nous qu’il nous aime tels que nous sommes vraiment. Qu’est-ce qu’il aura vu à l’intérieur de cette personne ? Que voit Jésus lorsqu’il regarde en nous et qu’il nous aime, malgré nos distractions et nos péchés ? Il voit notre fragilité, mais aussi notre désir d’être aimés tels que nous sommes.
En posant son regard sur lui – dit l’Évangile – « il l’aima » (v. 21). Jésus aime cet homme avant même de l’inviter à le suivre. Il l’aime tel qu’il est. L’amour de Jésus est gratuit, à l’opposé de la logique du mérite qui assaillait cette personne. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous réalisons que nous sommes aimés de cette manière, gratuitement, par grâce. Et cela vaut également dans les relations entre nous : tant que nous essayons d’acheter l’amour ou de mendier l’affection, ces relations ne nous rendront jamais heureux.
La proposition que Jésus fait à cet homme est de changer sa manière de vivre et d’être en relation avec Dieu. En effet, Jésus reconnaît qu’en lui, comme en chacun de nous, il y a un manque. C’est le désir que nous portons dans notre cœur d’être aimés. Il y a une blessure qui nous appartient en tant qu’êtres humains, la blessure par laquelle l’amour peut passer.
Pour combler ce manque, il ne faut pas « acheter » de la reconnaissance, de l’affection, de la considération, mais en revanche « vendre » tout ce qui nous alourdit, pour rendre notre cœur plus libre. On n’a pas besoin de continuer à prendre pour soi, mais plutôt de donner aux pauvres, de mettre à disposition, de partager.
Enfin, Jésus invite cet homme à ne pas rester seul. Il l’invite à le suivre, à rester dans un lien, à vivre une relation. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de sortir de l’anonymat. Nous ne pouvons entendre notre nom que dans une relation, dans laquelle quelqu’un nous appelle. Si nous restons seuls, nous n’entendrons jamais notre nom appelé et nous continuerons à rester des « untel », anonymes. Peut-être qu’aujourd’hui, précisément parce que nous vivons dans une culture de l’autosuffisance et de l’individualisme, nous nous trouvons plus malheureux parce que nous n’entendons plus notre nom prononcé par quelqu’un qui nous aime gratuitement.
Cet homme n’accepte pas l’invitation de Jésus et reste seul, parce que les ballasts de sa vie le maintiennent au port. La tristesse est le signe qu’il n’a pas pu partir. Parfois, nous pensons qu’il s’agit de richesses et ce ne sont que des fardeaux qui nous retiennent. L’espoir est que cette personne, comme chacun de nous, changera tôt ou tard et décidera de prendre le large.
Sœurs et frères, confions au Cœur de Jésus tous ceux qui sont tristes et indécis, afin qu’ils puissent sentir le regard aimant du Seigneur, qui s’émeut en nous regardant tendrement de l’intérieur.
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Nous concluons aujourd’hui le cycle consacré au zèle apostolique, au cours duquel la Parole de Dieu nous a inspirés à aider à cultiver la passion pour l’annonce de l’Evangile. Et cela concerne tout chrétien, dès le début. Pensons au fait que dans le baptême, le célébrant dit, en touchant les oreilles et les lèvres du baptisé: «Que le Seigneur Jésus, qui a fait entendre les sourds et parler les muets, t’accorde d’entendre bientôt sa parole et de professer ta foi».
Et nous avons entendu le prodige de Jésus. L’évangéliste Marc s’attarde à décrire le lieu où cela s’est produit: vers «la mer de Galilée» (Mc 7, 31). Qu’est-ce que ces territoires ont en commun? Le fait d’être habités majoritairement par des païens. Ce n’était pas des territoires habités par les juifs, mais majoritairement par des païens. Les disciples sont sortis avec Jésus, qui est capable d’ouvrir les oreilles et la bouche, c’est-à-dire le phénomène du mutisme et de la surdité, qui dans la Bible est également métaphorique, et désigne la fermeture aux appels de Dieu. Il existe une surdité physique, mais dans la Bible, celui qui est sourd à la parole de Dieu est muet, il ne communique pas la Parole de Dieu.
Un autre signe est indicatif: l’Evangile rapporte la parole décisive de Jésus en araméen, effatà, qui signifie «ouvre-toi», que s’ouvrent les oreilles et que se délie la langue et c’est une invitation adressée non pas tant au sourd-muet, qui ne pouvait pas l’entendre, mais précisément aux disciples de l’époque et de tous les temps. Nous aussi, qui avons reçu l’effatà de l’Esprit dans le Baptême, nous sommes appelés à nous ouvrir. «Ouvre-toi», dit Jésus à chaque -croyant et à son Eglise: ouvre-toi parce que le message de l’Evangile a besoin de toi pour être témoigné et proclamé! Et cela nous fait penser aussi à l’attitude d’un chrétien: le chrétien doit être ouvert à la Parole de Dieu et au service des autres. Les chrétiens fermés finissent mal, toujours, parce qu’ils ne sont pas chrétiens, ce sont des idéologues, des idéologues de la fermeture. Un chrétien doit être ouvert à l’annonce de la Parole, à l’accueil de ses frères et sœurs. Et pour cela, cet effatà, ce «ouvre-toi», est une invitation à nous tous à nous ouvrir.
Même à la fin des Evangiles, Jésus nous livre ce désir missionnaire: allez au-delà, allez paître, allez prêcher l’Evangile.
Frères, sœurs, sentons-nous tous appelés, en tant que baptisés, à témoigner et à annoncer Jésus. Et demandons la grâce, en tant qu’Eglise, de savoir mettre en œuvre une conversion pastorale et missionnaire. Le Seigneur, sur les rives de la mer de Galilée, a demandé à -Pierre s’il l’aimait et lui a ensuite demandé d’être le berger de ses brebis (cf. v. 15-17). Nous aussi, interrogeons-nous, qui chacun de nous se pose cette question, interrogeons-nous: est-ce que j’aime vraiment le Seigneur, au point de vouloir l’annoncer? Est-ce que je veux devenir son témoin ou est-ce que je me contente d’être son disciple? Est-ce que je prends à cœur les personnes que je rencontre, est-ce que je les amène à Jésus dans la prière? Est-ce que je désire faire quelque chose pour que la joie de l’Evangile, qui a transformé ma vie, embellisse aussi la leur? Pensons à cela, pensons à ces questions et allons de l’avant avec notre témoignage.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
Dans le cadre du parcours « Héritiers du Sacré-Coeur », le père Benoit Guédas nous propose une série de 8 vidéos pour approfondir la prière.
Retrouvez les enseignements du parcours :
Découvrez Je Chanterai de l’artiste français Matt Marvane, présent au Jesus Festival 2025,
Retrouvez les grandes figures de l’histoire de l’Église au fil des siècles et leurs liens au Sacré-Cœur. Ce dernier est bien plus vaste que ce que nous en percevons : Il habite votre cœur et Il a habité le cœur de bien des Saints auparavant !
Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans notre itinéraire de catéchèse sur les vices et les vertus, nous nous focalisons aujourd’hui sur un vice plutôt abominable, la tristesse, entendue comme un abattement de l’âme, une affliction constante qui empêche l’homme d’éprouver de la joie pour sa propre existence.
Il convient tout d’abord de noter que les Pères ont établi une distinction importante en ce qui concerne la tristesse. Il existe en effet une tristesse propre à la vie chrétienne qui, avec la grâce de Dieu, se transforme en joie : celle-ci n’est évidemment pas à rejeter et fait partie du chemin de conversion. Mais il y a aussi une deuxième sorte de tristesse qui s’insinue dans l’âme et la plonge dans l’abattement : c’est cette deuxième sorte de tristesse qu’il faut combattre résolument et de toutes ses forces, parce qu’elle vient du Malin. Nous retrouvons également cette distinction chez saint Paul, qui écrit aux Corinthiens : « Car une tristesse vécue selon Dieu produit un repentir qui mène au salut, sans causer de regrets, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » (2 Co 7,10).
Il y a donc une tristesse amicale, qui conduit au salut. Pensons au fils prodigue de la parabole : lorsqu’il touche le fond de sa déchéance, il ressent une grande amertume, qui le pousse à reprendre ses esprits et à décider de retourner dans la maison de son père (cf. Lc 15, 11-20). C’est une grâce de gémir sur ses péchés, de se rappeler l’état de grâce d’où nous sommes tombés, de se lamenter parce que nous avons perdu la pureté dans laquelle Dieu nous a rêvés.
Mais il existe une deuxième tristesse, qui au contraire est une maladie de l’âme. Elle naît dans le cœur de l’homme lorsqu’un désir ou une espérance s’évanouit. Nous pouvons ici nous référer au récit des disciples d’Emmaüs. Ces deux disciples quittent Jérusalem le cœur déçu et confient à l’étranger qui, un certain moment les accompagne : « Nous, nous espérions que c’était lui – c’est-à-dire Jésus – qui allait délivrer Israël. » (Lc 24, 21). La dynamique de la tristesse est liée à l’expérience de la perte. Dans le cœur de l’homme naissent des espoirs qui sont parfois déçus. Il peut s’agir du désir de posséder quelque chose que l’on ne peut pas obtenir, mais aussi de quelque chose d’important, comme une perte affective. Lorsque cela se produit, c’est comme si le cœur de l’homme tombait dans un précipice, et les sentiments qu’il éprouve sont le découragement, la faiblesse d’esprit, la dépression, l’angoisse. Nous passons tous par des épreuves qui génèrent en nous de la tristesse, parce que la vie nous fait concevoir des rêves qui se brisent ensuite. Dans cette situation, certains, après un temps de trouble, s’en remettent à l’espérance ; mais d’autres se complaisent dans la mélancolie, la laissant s’envenimer dans leur cœur. Cela procure-t-il du plaisir ? Considérez ceci. La tristesse est comme le plaisir du non-plaisir, être heureux que cela ne soit pas arrivé, c’est comme prendre un bonbon amer, sans sucre, un bonbon abominable et le sucer. La tristesse est un plaisir de non-plaisir.
Le moine Évagre raconte que tous les vices visent le plaisir, aussi éphémère soit-il, alors que la tristesse jouit du contraire : se bercer d’un chagrin sans fin. Certains chagrins prolongés, où l’on continue à élargir le vide de celui qui n’est plus là, ne sont pas propres à la vie dans l’Esprit. Certaines amertumes rancunières, où l’on a toujours en tête une revendication qui nous fait prendre l’apparence de la victime, ne produisent pas en nous une vie saine, et encore moins une vie chrétienne. Il y a quelque chose dans le passé de chacun qui a besoin d’être guéri. La tristesse, qui est une émotion naturelle, peut se transformer en un mauvais état d’esprit.
C’est un démon sournois, celui de la tristesse. Les pères du désert la décrivaient comme un ver du cœur, qui ronge et vide ceux qui lui font l’hospitalité. Cette image est belle, elle nous fait comprendre. Et alors que dois-je faire quand je suis triste ? S’arrêter et réfléchir : est-ce une bonne tristesse ? Est-ce une tristesse qui n’est pas bonne ? Et réagir en fonction de la nature de la tristesse. N’oubliez pas que la tristesse peut être une très mauvaise chose qui nous conduit au pessimisme, qui nous conduit à un égoïsme difficile à guérir.
Frères et sœurs, soyons attentifs à cette tristesse et pensons que Jésus nous apporte la joie de la résurrection. Même si la vie peut être remplie de contradictions, de désirs déconfits, de rêves non réalisés, d’amitiés perdues, grâce à la résurrection de Jésus, nous pouvons croire que tout sera sauvé. Jésus est ressuscité non seulement pour lui-même, mais aussi pour nous, afin de racheter tous les bonheurs restés inachevés dans notre vie. La foi chasse la peur, et la résurrection du Christ dégage la tristesse comme la pierre du tombeau. Chaque journée de chrétien est un exercice de résurrection. Georges Bernanos, dans son célèbre roman Journal d’un curé de campagne, fait dire au curé de Torcy : « L’Église dispose de la joie, toute cette joie qui est réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, vous l’avez fait contre la joie ». Et un autre écrivain français, Léon Bloy, nous a laissé cette phrase magnifique : « Il n’y a qu’une seule tristesse, […] celle de n’être pas saint ». Que l’Esprit de Jésus ressuscité nous aide à vaincre la tristesse par la sainteté.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
Retrouvez les grandes figures de l’histoire de l’Église au fil des siècles et leurs liens au Sacré-Cœur. Ce dernier est bien plus vaste que ce que nous en percevons : Il habite votre cœur et Il a habité le cœur de bien des Saints auparavant !
Retrouvez les grandes figures de l’histoire de l’Église au fil des siècles et leurs liens au Sacré-Cœur. Ce dernier est bien plus vaste que ce que nous en percevons : Il habite votre cœur et Il a habité le cœur de bien des Saints auparavant !
« La dévotion à Notre Dame du Mont Carmel plonge ses racines – et c’est un cas unique – neuf siècles avant la naissance de la Vierge Marie.
Voici l’histoire : alors qu’il demeurait sur le Mont Carmel, le prophète Elie eut la vision d’une nuée blanche montant de la mer (1 Rois 18), portant avec elle une pluie providentielle pour la terre d’Israël, alors dévastée par une terrible sècheresse. La Tradition y a vu l’annonce prophétique du mystère de la Vierge et de la naissance du Fils de Dieu.
Dès le premier siècle, des ermites, voulant suivre l’exemple des prophètes Elie et d’Elisée, se retirèrent sur le Mont Carmel et y construisirent une petite chapelle consacrée à Marie. »



Catéchèse sur le discernement
1. Que signifie discerner ?
Chers frères et sœurs,
Nous commençons aujourd’hui, un nouveau cycle de catéchèses : nous avons terminé les catéchèses sur la vieillesse, à présent, nous commençons un nouveau cycle sur le thème du discernement. Discerner est un acte important qui concerne tout le monde, car les choix sont une partie essentielle de la vie. Discerner les choix. On choisit une nourriture, un vêtement, un parcours d’études, un travail, une relation. Dans tout cela, se concrétise un projet de vie et également notre relation avec Dieu.
Dans l’Evangile, Jésus parle de discernement avec des images tirées de la vie ordinaire ; par exemple, il décrit les pêcheurs qui sélectionnent de bons poissons et rejettent les mauvais ; ou le marchand qui sait identifier, parmi de nombreuses perles, celle qui a le plus de valeur. Ou celui qui, en labourant un champ, tombe sur quelque chose qui se révèle être un trésor (cf. Mt 13, 44-48).
A la lumière de ces exemples, le discernement se présente comme un exercice d’intelligence, mais aussi de capacité et aussi de volonté, pour saisir le bon moment : ce sont les conditions pour faire un bon choix. Il faut de l’intelligence, de l’expertise et aussi la volonté pour faire un bon choix. Et il y a aussi un coût pour que le discernement devienne opérationnel. Pour exercer au mieux son métier, le pêcheur tient compte de l’effort, des longues nuits passées en mer, puis du fait de rejeter une partie de la pêche, en acceptant une perte de profit pour le bien de ceux auquel il est destiné. Le marchand de perles n’hésite pas à tout dépenser pour acheter cette perle ; et il en va de même pour l’homme qui a découvert un trésor. Des situations inattendues, non programmées, où il est essentiel de reconnaître l’importance et l’urgence d’une décision à prendre. Les décisions doivent être prises par chacun de nous ; personne ne les prend pour nous. A un certain moment, les adultes, libres, peuvent demander conseil, réfléchir, mais la décision leur appartient ; on ne peut pas dire : « J’ai perdu cela, parce que mon mari a décidé, ma femme a décidé, mon frère a décidé » : non ! Tu dois décider, chacun de nous doit décider, et pour cela il est important de savoir discerner : pour bien décider, il faut savoir discerner.
L’Evangile suggère un autre aspect important du discernement : il touche les liens d’affection. Celui qui a trouvé le trésor n’éprouve pas la difficulté de tout vendre, tant sa joie est grande (cf. Mt 13, 44). Le terme utilisé par l’évangéliste Matthieu indique une joie très spéciale, qu’aucune réalité humaine ne peut donner ; et en effet, elle revient dans très peu d’autres passages de l’Evangile, qui renvoient tous à la rencontre avec Dieu. C’est la joie des Mages quand, après un -voyage long et fatigant, ils revoient l’étoile (cf. Mt 2, 10); la joie, c’est la joie des femmes qui reviennent du tombeau vide après avoir entendu l’annonce de la résurrection de la part de l’ange (cf. Mt 28, 8 ). C’est la joie de qui a trouvé le Seigneur. Prendre une belle décision, une décision juste, te conduit toujours à cette joie finale ; peut-être que sur le chemin, il faut subir un peu d’incertitude, réfléchir, chercher, mais à la fin, la bonne décision te procure de la joie.
Lors du jugement dernier, Dieu opérera un discernement — le grand discernement — envers nous. Les images du paysan, du pêcheur et du marchand sont des exemples de ce qui se passe dans le Royaume des cieux, un Royaume qui se manifeste dans les actions ordinaires de la vie, qui exigent de prendre position. C’est pourquoi il est si important de savoir discerner : les grands choix peuvent naître de circonstances a priori secondaires, mais qui s’avèrent décisives. Pensons par exemple à la première rencontre d’André et de Jean avec Jésus, une rencontre qui naît d’une simple question : « Rabbi, où demeures-tu ? » — « Venez et voyez » (cf. Jn 1, 38-39), dit Jésus. Un échange très bref, mais c’est le début d’un changement qui, peu à peu, marquera toute la vie. Des années plus tard, l’évangéliste continuera à se souvenir de cette rencontre qui l’a changé pour toujours, il se souviendra aussi de l’heure : « C’était environ la dixième heure » (v. 39). C’est le moment où le temps et l’éternel se sont rencontrés dans sa vie. Et dans une décision bonne et juste, la volonté de Dieu rencontre notre volonté ; le chemin actuel rencontre l’éternel. Prendre une bonne décision, après un chemin de discernement, c’est faire cette rencontre : le temps avec l’éternel.
Donc : connaissance, expérience, liens d’affection, volonté : voilà quelques éléments indispensables du discernement. Au cours de ces catéchèses, nous en verrons d’autres, tout aussi importantes.
Le discernement — comme je l’ai dit — implique un effort. Selon la Bible, nous ne sommes pas face à la vie que nous devons vivre, déjà prête à l’emploi : non ! Nous devons la décider en permanence, en fonction des réalités qui se présentent. Dieu nous invite à évaluer et à choisir : il nous a créés libres et veut que nous exercions notre liberté. Pour cette raison, le discernement est exigeant.
Nous avons souvent fait cette expérience : choisir quelque chose qui nous paraissait bien mais qui ne l’était pas. Ou bien savoir quel était notre vrai bien et ne pas le choisir. L’homme, contrairement aux animaux, peut se tromper, il peut ne pas vouloir choisir correctement et la Bible le montre dès ses premières pages. Dieu donne à l’homme une consigne précise : si tu veux vivre, si tu veux goûter à la vie, souviens-toi que tu es une créature, que tu n’es pas le critère du bien et du mal et que les choix que tu feras auront une conséquence, pour toi, pour les autres et pour le monde (cf. Gn 2, 16-17) ; tu peux faire de la terre un jardin magnifique ou tu peux en faire un désert de mort. Un enseignement fondamental : ce n’est pas un hasard si c’est le premier dialogue entre Dieu et l’homme. Le dialogue est : le Seigneur donne la mission, tu dois faire ceci et cela ; et chaque pas que fait l’homme doit discerner quelle décision prendre. Le discernement est cette réflexion de l’esprit, du cœur que nous devons faire avant de prendre une décision.
Le discernement est difficile, mais indispensable pour vivre. Cela exige que je me connaisse, que je sache ce qui est bon pour moi ici et maintenant. Il exige avant tout une relation filiale avec Dieu. Dieu est Père et ne nous laisse pas seuls, il est toujours prêt à nous conseiller, à nous encourager, à nous accueillir. Mais il n’impose jamais sa volonté. Pourquoi ? Parce qu’il veut être aimé et non craint. Et Dieu veut aussi que nous soyons des enfants, et pas des esclaves : des enfants libres. Et l’amour ne peut être vécu que dans la liberté. Pour apprendre à vivre, il faut apprendre à aimer, et pour cela il faut discerner : que puis-je faire maintenant, face à cette alternative ? Que ce soit un signe de plus d’amour, de plus de maturité en amour. Demandons que le Saint-Esprit nous guide ! Invoquons-le chaque jour, surtout quand nous devons faire des choix. Merci.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Demain, nous célébrerons la solennité de la Toussaint. Chaque jour, pendant 15 jours, retrouvez un saint qui a précédé et préparé les apparitions du Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Marguerite-Marie s’inscrit ainsi dans la longue lignée des saints qui furent des disciples bien-aimés du Sacré-Cœur avant et après elle.

SAINTE THÉRESE DE L’ENFANT JÉSUS (1873-1897)
La sainte patronne des missions nous encourage à offrir toutes les joies et épreuves de notre vie et de les unir au Cœur de Jésus qui saura leur faire porter du fruit. Dès le début du jour, nous pouvons lui offrir toutes notre journée :
« Mon Dieu, je Vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui, dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ; je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d’accomplir parfaitement Votre sainte volonté, d’accepter pour Votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. »
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
Homélie
Dimanche 13 novembre 2022
Alors que certains parlent de la beauté extérieure du Temple et admirent ses pierres, Jésus éveille l’attention sur les événements troublés et dramatiques qui marquent l’histoire humaine. En effet, alors que le Temple construit par la main de l’homme passera, comme passent toutes les choses de ce monde, il est important de savoir discerner le temps que nous vivons, pour rester disciples de l’Evangile même au milieu des bouleversements de l’histoire.
Et, pour nous indiquer la manière de discerner, le Seigneur nous offre deux exhortations : ne vous laissez pas égarer et témoignez.
La première chose que Jésus dit à ses auditeurs, préoccupés par le « quand » et le « comment » se produiront les faits effrayants dont il parle, est : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux » (Lc 21, 8). Et il ajoute : « Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés » (v. 9). Et c’est ce qui nous arrive en ce moment. De quelle tromperie Jésus veut-il donc nous libérer ? De la tentation de lire les faits les plus dramatiques de manière superstitieuse ou catastrophique, comme si nous étions désormais proches de la fin du monde et qu’il ne valait plus la peine de nous engager dans rien de bon. Lorsque nous pensons de cette façon, nous nous laissons guider par la peur, et peut-être nous cherchons des réponses, avec une curiosité maladive, dans les sornettes des mages ou des horoscopes, qui ne manquent jamais – et aujourd’hui beaucoup de chrétiens vont voir les mages, regardent l’horoscope comme si c’était la voix de Dieu – ou, encore, nous faisons confiance à des théories fantaisistes avancées par quelque « messie » de la dernière heure, en général toujours défaitiste et complotiste. La psychologie du complot est mauvaise, elle fait du mal. L’Esprit du Seigneur ne se trouve pas là : ni dans le fait d’aller chercher un gourou, ni dans cet esprit du complot, le Seigneur n’est pas là. Jésus nous avertit : « Ne vous laissez pas égarer », ne vous laissez pas éblouir par une curiosité crédule, n’affrontez pas les événements en étant mus par la peur, mais apprenez plutôt à lire les événements avec les yeux de la foi, certains qu’en restant proches de Dieu « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu» (v. 18).
Si l’histoire humaine est constellée d’événements dramatiques, de situations douloureuses, de guerres, de révolutions et de calamités, il est tout aussi vrai – dit Jésus – que tout cela n’est pas la fin (cf. 9). Ce n’est pas une raison pour se laisser paralyser par la peur ou céder au défaitisme de ceux qui pensent que tout est perdu désormais, et qu’il est inutile de s’engager dans la vie. Le disciple du Seigneur ne se laisse pas atrophier par la résignation, il ne cède pas au découragement même dans les situations les plus difficiles parce que son Dieu est le Dieu de la résurrection et de l’espérance, qui relève toujours : avec Lui on peut toujours lever le regard, recommencer et repartir. Le chrétien s’interroge alors devant l’épreuve, quelque soit l’épreuve, culturelle, historique, personnelle : « Que nous dit le Seigneur à travers ce moment de crise? » Moi aussi je pose cette question aujourd’hui : qu’est-ce que nous dit le Seigneur par cette troisième guerre mondiale ? Qu’est-ce que nous dit le Seigneur ? Et, alors que se produisent des évènements mauvais qui engendrent pauvreté et souffrance, Le chrétien se demande : « Qu’est-ce que, concrètement, je peux faire de bien ? » Ne pas fuir, se poser la question, qu’est-ce que me dit le Seigneur, qu’est-ce que je peux faire de bien ?
Ce n’est pas par hasard que la deuxième exhortation de Jésus qui suit « ne vous laissez pas égarer », est en positif. Il dit : « Cela vous amènera à rendre témoignage » (v. 13). Occasion de rendre témoignage. Je voudrais souligner ce beau mot : occasion. Il signifie avoir la possibilité de faire quelque chose de bien à partir des circonstances de la vie, même quand elles ne sont pas idéales. C’est un bel art typiquement chrétien : ne pas rester victimes de ce qui arrive, – le chrétien n’est pas victime et la psychologie de la victimisation est mauvaise, elle fait du mal – mais saisir l’opportunité qui se cache dans tout ce qui nous arrive, le bien qu’il est possible – ce peu de bien qu’il est possible de faire -, et construire également à partir de situations négatives. Toute crise est une opportunité et offre des occasions de croissance. Parce que toute crise est ouverte à la présence de Dieu, à la présence de l’humanité. Mais que nous fait l’esprit mauvais ? Il veut que nous transformions la crise en conflit, et le conflit est toujours fermé, sans horizon et sans issue. Non. Vivons la crise en tant que personnes humaines, en tant que chrétiens, ne la transformons pas en conflit car toute crise est une possibilité et offre une occasion de croissance. Nous nous en apercevons lorsque nous relisons notre histoire personnelle : dans la vie, souvent, les pas en avant les plus importants se font précisément à l’intérieur de certaines crises, de situations d’épreuve, de perte de contrôle, d’insécurité. Et alors, nous comprenons l’invitation que Jésus adresse aujourd’hui directement à moi, à toi, à chacun de nous : pendant que tu vois autour de toi des faits bouleversants, pendant que se soulèvent guerres et conflits, pendant que se produisent tremblements de terre, famines et pestes, toi, qu’est-ce que tu fais ? Moi, qu’est-ce que je fais ? Tu te distrais pour ne pas y penser? Tu t’amuses pour ne pas t’impliquer? Tu prends la route de la mondanité, celle de ne pas prendre en main, de ne pas prendre à cœur ces situations dramatiques ? Tu te détournes pour ne pas voir? Tu t’adaptes, soumis et résigné, à ce qui arrive ? Ou ces situations deviennent-elles des occasions pour témoigner de l’Évangile ? Aujourd’hui chacun de nous doit s’interroger devant tant de calamités, devant cette troisième guerre mondiale si cruelle, devant la faim de tant d’enfants, de tant de personnes : est-ce que je peux gaspiller, gaspiller de l’argent, gaspiller ma vie, gaspiller le sens de ma vie sans prendre le courage et avancer ?
Frères et sœurs, en cette Journée Mondiale des Pauvres, la Parole de Jésus est un avertissement fort à rompre cette surdité intérieure que nous avons tous et qui nous empêche d’écouter le cri de douleur étouffé des plus faibles. Aujourd’hui encore, nous vivons dans des sociétés blessées et nous assistons, comme nous l’a dit l’Évangile, à des scènes de violence, – il suffit de penser à la cruauté dont souffre le peuple ukrainien – d’injustice et de persécution. De plus, nous devons faire face à la crise engendrée par le changement climatique et la pandémie qui a laissé derrière elle un sillage de malaises non seulement physiques, mais aussi psychologiques, économiques et sociaux. Aujourd’hui encore, frères et sœurs, nous voyons se soulever des peuples contre des peuples et nous assistons angoissés à l’élargissement véhément des conflits, au malheur de la guerre qui provoque la mort de tant d’innocents et multiplie le venin de la haine. Aujourd’hui encore, beaucoup plus qu’hier, de nombreux frères et sœurs, éprouvés et découragés, migrent en quête d’espérance, et beaucoup de personnes vivent dans la précarité en raison du manque de travail ou de conditions de travail injustes et indignes. Et aujourd’hui encore, les pauvres sont les victimes les plus pénalisées de toutes les crises. Mais, si notre cœur est étouffé et indifférent, nous ne pouvons pas entendre leur faible cri de douleur, pleurer avec eux et pour eux, voir combien de solitude et d’angoisse se cachent même dans les recoins oubliés de nos villes. Il est nécessaire d’aller aux recoins des villes, ces recoins cachés et sombres : là, on voit beaucoup de misères et beaucoup de souffrances, et beaucoup de pauvretés rejetées.
Faisons nôtre l’invitation forte et claire de l’Evangile à ne pas nous laisser tromper. N’écoutons pas les prophètes de malheur; ne nous laissons pas enchanter par les sirènes du populisme qui instrumentalise les besoins du peuple en proposant des solutions trop faciles et hâtives. Ne suivons pas les faux « messies » qui, au nom du gain, proclament des recettes qui ne font qu’accroître la richesse de quelques-uns, condamnant les pauvres à la marginalisation. Au contraire, rendons témoignage : allumons des lumières d’espérance au milieu des ténèbres; saisissons, dans les situations dramatiques, des occasions pour témoigner de l’Evangile de la joie et construire un monde fraternel, au moins un peu plus fraternel; engageons-nous avec courage pour la justice, la légalité et la paix, en étant toujours aux côtés des plus faibles. Ne fuyons pas pour nous défendre de l’histoire, mais luttons pour donner à cette histoire que nous sommes en train de vivre un visage différent.
Et où trouver la force pour tout cela ? Dans le Seigneur. Dans la confiance en Dieu qui est Père et qui veille sur nous. Si nous lui ouvrons notre cœur, il augmentera en nous la capacité d’aimer. Voilà la voie : grandir en amour. Jésus, en effet, après avoir parlé de scénarios de violence et de terreur, conclut en disant : « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » (v. 18). Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’Il est avec nous, Il est notre gardien, Il marche avec nous. Est-ce que j’ai cette foi ? As-tu cette foi que le Seigneur marche avec toi ? Cela, nous devons toujours nous le répéter, spécialement dans les moments les plus douloureux : Dieu est Père et il est à mes côtés, il me connaît et il m’aime, il veille sur moi, il dort pas, il prend soin de moi et, avec Lui, pas un seul cheveu de ma tête ne sera perdu. Et comment est-ce que je réponds à cela ? En regardant les frères et sœurs qui sont dans le besoin, en regardant cette culture du rebut qui écarte les pauvres, qui écarte les personnes qui ont moins de possibilités, qui écarte les personnes âgées, qui écarte les enfants à naître… En regardant tout cela, qu’est-ce que je sens devoir faire comme chrétien à ce moment ?
Bien-aimés par Lui, décidons-nous à aimer les enfants les plus rejetés. Le Seigneur est là. Il existe une vielle tradition, même dans les petits villages de l’Italie quelques personnes la maintiennent : au dîner de Noël, laisser une place libre pour le Seigneur qui frappera certainement à la porte en la personne d’un pauvre dans le besoin. Est-ce que ton cœur a toujours une place de libre pour ces personnes ? Est-ce que mon cœur a toujours une place de libre pour ces personnes ? Ou bien sommes-nous tellement occupés avec les amis, les événements sociaux, les obligations ? N’avons-nous jamais une place de libre pour ces personnes ? Prenons soin des pauvres en qui se trouve le Christ qui, pour nous, s’est fait pauvre (cf 2 Co 8, 9). Il s’identifie avec le pauvre. Sentons-nous interpellés pour qu’aucun cheveu de leur tête ne soit perdu. Nous ne pouvons pas rester, comme ceux dont parle l’Evangile, à admirer les belles pierres du Temple sans reconnaître le vrai Temple de Dieu, l’être humain, homme et femme, spécialement le pauvre, dans le visage duquel, dans l’histoire duquel, dans les blessures duquel se trouve Jésus. C’est Lui qui l’a dit. Ne l’oublions jamais.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana



Personne ne peut se sauver tout seul.
Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix
« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit » (Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2).
1. L’Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique à rester ferme dans l’attente de la rencontre avec le Seigneur, les pieds et le cœur sur terre, capable de porter un regard attentif sur la réalité et les événements de l’histoire. C’est pourquoi, même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l’injustice et de la souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l’espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. C’est pourquoi saint Paul exhorte constamment la communauté à veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité : « Ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres » (5, 6). C’est une invitation à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, la souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, à ne pas nous décourager, mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veiller et de saisir les premières lueurs de l’aube, surtout aux heures les plus sombres.
2. La Covid-19 nous a plongés dans la nuit, déstabilisant notre vie ordinaire, chamboulant nos plans et nos habitudes, bouleversant l’apparente tranquillité des sociétés, même les plus privilégiées, entrainant désorientation et souffrance, causant la mort de beaucoup de nos frères et sœurs.
Entrainé dans un tourbillon de défis imprévus et dans une situation qui n’était pas très claire, même du point de vue scientifique, le monde de la santé s’est mobilisé pour soulager la douleur de nombre de personnes et tenter d’y remédier, tout comme les Autorités politiques qui ont dû prendre des mesures importantes en termes d’organisation et de gestion de l’urgence.
En plus des manifestations physiques, la Covid-19 a provoqué, parfois à long terme, un malaise général qui a grandi dans le cœur de nombreux individus et familles, avec des effets considérables alimentés par de longues périodes d’isolement et diverses restrictions de liberté.
En outre, nous ne pouvons pas oublier la manière dont la pandémie a touché certains aspects sensibles de l’ordre social et économique, faisant ressortir des contradictions et des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l’emploi de nombreuses personnes et aggravé la solitude de plus en plus répandue dans nos sociétés, notamment celle des plus faibles et des pauvres. Pensons, par exemple, aux millions de travailleurs clandestins dans de nombreuses régions du monde, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien durant tout le confinement.
Les individus et la société progressent rarement dans des situations générant un tel sentiment de défaite et d’amertume : ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour la paix et provoque des conflits sociaux, des frustrations et des violences de toutes sortes. En ce sens, la pandémie semble avoir bouleversé même les parties les plus paisibles de notre monde, faisant ressortir d’innombrables fragilités.
3. Après trois années, l’heure est venue de prendre le temps de nous interroger, d’apprendre, de grandir et de nous laisser transformer, tant individuellement que communautairement ; un temps privilégié pour se préparer au « jour du Seigneur ». J’ai déjà eu l’occasion de répéter qu’on ne sort jamais identiques des moments de crise : on en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd’hui, nous sommes appelés à nous demander : qu’avons-nous appris de cette situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés, pour oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d’espérance pouvons-nous saisir pour aller de l’avant et essayer de rendre notre monde meilleur ?
Après avoir touché du doigt la fragilité qui caractérise la réalité humaine ainsi que notre existence personnelle, nous pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée par la Covid-19 est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune, et que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble les valeurs universelles qui tracent le chemin de cette fraternité humaine. Nous avons également appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n’a pas seulement été excessive, mais s’est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix. Dans notre monde qui court très vite, les problèmes généralisés de déséquilibres, d’injustices, de pauvretés et de marginalisations alimentent très souvent des troubles et des conflits, et engendrent des violences voire des guerres.
Tandis que, d’une part, la pandémie a fait émerger tout cela, nous avons fait d’autre part des découvertes positives : un retour bénéfique à l’humilité ; une réduction de certaines prétentions consuméristes ; un sens renouvelé de la solidarité qui nous incite à sortir de notre égoïsme pour nous ouvrir à la souffrance des autres et à leurs besoins ; un engagement, parfois vraiment héroïque, de tant de personnes qui se sont dépensées pour que tous puissent mieux surmonter le drame de l’urgence.
Il a résulté de cette expérience une conscience plus forte qui invite chacun, peuples et nations, à remettre au centre le mot « ensemble ». En effet, c’est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la justice et que nous surmontons les événements les plus douloureux. En effet, les réponses les plus efficaces à la pandémie ont été celles qui ont vu des groupes sociaux, des institutions publiques et privées, des organisations internationales, s’unir pour relever le défi en laissant de côté les intérêts particuliers. Seule la paix qui naît de l’amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales.
4. Dans le même temps, au moment où nous osions espérer que le pire de la nuit de la pandémie de Covid-19 avait été surmonté, une nouvelle calamité terrible s’est abattue sur l’humanité. Nous avons assisté à l’apparition d’un autre fléau : une guerre de plus, en partie comparable à la Covid-19 mais cependant motivée par des choix humains coupables. La guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et répand l’incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance, souffrent des effet collatéraux – il suffit de penser aux problèmes du blé et du prix du carburant.
Ce n’est certes pas l’ère post-Covid que nous espérions ou attendions. En effet, cette guerre, comme tous les autres conflits répandus de par le monde, est une défaite pour l’humanité entière et pas seulement pour les parties directement impliquées. Alors qu’un vaccin a été trouvé pour la Covid-19, des solutions adéquates n’ont pas encore été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, car il ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché (cf. Évangile de Marc 7, 17-23).
5. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d’abord, de nous laisser changer le cœur par l’urgence que nous avons vécue, c’est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d’interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l’espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire c’est-à-dire comme un « nous » ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d’un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d’un bien qui soit vraiment commun.
Pour y parvenir et vivre mieux après l’urgence de la Covid-19, nous ne pouvons pas ignorer un fait fondamental : les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels sont en réalité causes ou conséquences les unes des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde, avec responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous ; promouvoir des actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté ; prendre soin, de manière concertée, de notre maison commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique ; combattre le virus des inégalités et garantir l’alimentation ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n’ont pas même un salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples affamés nous blesse. Nous devons développer, avec des politiques appropriées, l’accueil et l’intégration, en particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n’est qu’en nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l’amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le Royaume de Dieu qui est un Royaume d’amour, de justice et de paix.
En partageant ces réflexions, je souhaite qu’au cours de la nouvelle année, nous puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l’histoire peut nous apprendre. Je présente mes meilleurs vœux aux Chefs d’État et de Gouvernement, aux Responsables des Organisations internationales, aux Leaders des différentes religions. À tous les hommes et femmes de bonne volonté, je leur souhaite de construire, jour après jour en artisans de la paix, une bonne année ! Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et Reine de la Paix, intercède pour nous et pour le monde entier.
Du Vatican, le 8 décembre 2022
François
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
LETTRE APOSTOLIQUE TOTUM AMORIS EST
Pour le 4ème centenaire de la mort de Saint François de Sales
« Tout est à l’amour ». [1] Dans ses paroles nous pouvons recueillir l’héritage spirituel laissé par saint François de Sales qui est mort à Lyon le 28 décembre 1622. Prince-évêque « en exil » de Genève depuis une vingtaine d’années, il avait un peu plus de cinquante ans. Il était arrivé à Lyon après sa dernière mission diplomatique, le Duc de Savoie lui ayant demandé d’accompagner le Cardinal Maurice de Savoie en Avignon. Ensemble, ils avaient rendu hommage au jeune Roi Louis XIII, sur son chemin de retour vers Paris par la vallée du Rhône après une campagne militaire victorieuse dans le Sud de la France. Fatigué et en mauvaise santé, François s’était mis en route par pur esprit de service. « S’il n’était pas très utile à leur service que je fasse ce voyage, j’aurais certainement beaucoup de bonnes et solides raisons pour m’en dispenser ; mais s’il s’agit de leur service, mort ou vivant, je ne me retirerai pas, mais j’irai ou je me ferai traîner ». [2] C’était son tempérament. À Lyon, il logea au monastère des Visitandines, dans la maison du jardinier afin de ne pas trop déranger et pour être en même temps plus libre de rencontrer ceux qui le désiraient.
Désormais peu impressionné par les « faibles grandeurs de la cour » [3], il avait passé ses derniers jours à exercer son ministère de pasteur dans une succession de rendez-vous : confessions, conversations, conférences, prédications ainsi que les incontournables ultimes lettres d’amitié spirituelle. La raison profonde de ce style de vie remplie de Dieu lui était devenue de plus en plus claire au fil du temps, et il l’avait formulée de manière simple et précise dans son célèbre Traité de l’amour de Dieu : « Sitôt que l’homme pense un peu attentivement à la Divinité, il sent une certaine douce émotion du cœur, qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain ». [4] Voilà la synthèse de sa pensée. L’expérience de Dieu est une évidence pour le cœur humain. Il ne s’agit pas d’une construction mentale mais d’une reconnaissance, pleine d’émerveillement et de gratitude, qui fait suite à la manifestation de Dieu. C’est dans le cœur et par le cœur que s’accomplit ce processus d’unification subtil et intense en vertu duquel l’homme reconnaît Dieu et, en même temps, se reconnaît lui-même, reconnaît son origine, sa profondeur et son accomplissement dans l’appel à l’amour. Il découvre que la foi n’est pas un mouvement aveugle, mais avant tout une attitude du cœur. Par elle, l’homme s’en remet à une vérité qui apparaît à sa conscience comme une “douce émotion”, capable de susciter en retour un bon vouloir auquel nul ne saurait renoncer pour toute réalité créée, comme il aimait à le dire.
A cette lumière, on comprend que, pour saint François de Sales, il n’y avait pas de meilleur lieu pour trouver Dieu, et pour aider à le chercher, que le cœur de chaque homme et de chaque femme de son temps. Il l’avait appris en s’observant lui-même attentivement dès son plus jeune âge, et en scrutant le cœur humain.
Lors de sa dernière rencontre de ces jours-là, à Lyon avec ses Visitandines, dans le climat intime d’un quotidien habité par Dieu, il leur avait laissé cette expression par laquelle il aurait voulu que sa mémoire soit plus tard fixée en elles : « J’ai tout résumé dans ces deux mots quand je vous ai dit de ne rien refuser ni désirer ; je n’ai plus rien à vous dire ». [5] Il ne s’agissait cependant pas d’un exercice de pur volontarisme, « une volonté sans humilité », [6] de cette tentation subtile sur le chemin de la sainteté qui confond celle-ci avec la justification par ses propres forces, avec l’adoration de la volonté humaine et de sa propre capacité, « qui aboutit à une autosatisfaction égocentrique et élitiste dépourvue de véritable amour ». [7] Il ne s’agissait pas non plus d’un pur quiétisme, d’un abandon passif et sans affects à une doctrine sans chair et sans histoire. [8] Cette formule naissait plutôt de la contemplation de la vie même du Fils incarné. Le 26 décembre le Saint s’adressait ainsi aux Sœurs au cœur du mystère de Noël : « Voyez-vous l’Enfant Jésus dans la crèche ? Il reçoit tous les ravages du temps, le froid et tout ce que le Père permet qu’il lui arrive. Il ne refuse pas les petites consolations que sa mère lui donne, et il n’est pas écrit qu’il tende jamais les mains pour avoir le sein de sa Mère, mais il laisse tout à ses soins et à sa prévoyance ; ainsi nous ne devons rien désirer ni refuser, supportant tout ce que Dieu nous envoie, le froid et les ravages du temps ». [9] Son attention à reconnaître comme indispensable le soin de tout ce qui est humain est émouvante. À l’école de l’Incarnation, il avait appris à lire l’histoire et à l’habiter avec confiance.
Le critère de l’amour
Par expérience, il avait reconnu que le désir est la racine de toute vraie vie spirituelle et, en même temps, le lieu de sa contrefaçon. C’est pourquoi, en recueillant largement la tradition spirituelle qui l’avait précédé, il avait compris l’importance de mettre constamment le désir à l’épreuve par un continuel exercice de discernement. Il avait retrouvé dans l’amour le critère ultime de son évaluation. Toujours lors de son dernier séjour à Lyon, en la fête de saint Étienne, deux jours avant sa mort, il avait déclaré : « C’est l’amour qui donne la perfection à nos œuvres. Je vous dis bien plus : voilà une personne qui souffre le martyre pour Dieu avec une once d’amour, elle mérite beaucoup, on ne saurait donner davantage que sa vie ; mais une autre personne qui ne souffrira qu’une chiquenaude avec deux onces d’amour aura beaucoup plus de mérite, parce que c’est la charité et l’amour qui donne le prix à nos œuvres ». [10]
De manière concrète et surprenante, il avait poursuivi en illustrant la relation difficile entre contemplation et action : « Vous savez ou devriez savoir que la contemplation est en soi meilleure que l’action et la vie active ; mais si dans la vie active on trouve une plus grande union [avec Dieu], alors elle est meilleure. Si une sœur, qui est dans la cuisine et maintient la casserole sur le feu, a plus d’amour et de charité qu’une autre, le feu matériel ne la retiendra pas, mais l’aidera à être plus agréable à Dieu. Il arrive assez souvent que l’on soit uni à Dieu dans l’action comme dans la solitude ; en fin de compte, j’en reviens toujours à la question de savoir où l’on trouve le plus d’amour ». [11] C’est la vraie question qui surpase toute rigidité inutile ou repli sur soi : se demander à chaque instant, pour chaque choix, dans chaque circonstance de la vie, où se trouve le plus grand amour. Ce n’est pas un hasard si saint François de Sales a été appelé par saint Jean-Paul II « le Docteur de l’amour divin », [12] non seulement parce qu’il en a écrit un puissant Traité, mais surtout parce qu’il en a été témoin. Par ailleurs, ses écrits ne peuvent pas être considérés comme une théorie rédigée sur le papier, loin des préoccupations de l’homme ordinaire, car son enseignement est né d’une observation attentive de l’expérience. Il n’a fait que transformer en doctrine ce qu’il vivait et déchiffrait avec acuité, éclairé par l’Esprit, dans son action pastorale singulière et novatrice. Une synthèse de sa manière de procéder se retrouve dans la préface de ce même Traité sur l’amour de Dieu : « Tout est à l’amour, pour l’amour et d’amour en la sainte Église ». [13]
Les années de formation initiale : l’aventure de la connaissance de soi en Dieu
Il est né le 21 août 1567, au château de Sales, près de Thorens, de François de Nouvelles, seigneur de Boissy, et de Françoise de Sionnaz. « Ayant vécu à cheval entre deux siècles, le XVI e et le XVII e, il rassemblait en lui le meilleur des enseignements et des conquêtes culturelles du siècle qui s’achevait, réconciliant l’héritage de l’humanisme et la tension vers l’absolu propre aux courants mystiques ». [14]
Après sa formation culturelle initiale, au collège de La Roche-sur-Foron pour commencer puis à Annecy, il vint à Paris, au tout nouveau collège jésuite de Clermont. Dans la capitale du Royaume de France, dévastée par les guerres de religion, il vécut deux crises intérieures consécutives qui marqueront sa vie de manière indélébile. Cette prière ardente faite dans l’église Saint-Etienne-des-Grès, devant la Vierge noire de Paris, allumera dans son cœur, au milieu des ténèbres, une flamme qui restera vivante en lui pour toujours, comme une clé de compréhension de ses propres expériences et de celles des autres. « Quoi qu’il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains, et dont les voies sont justice et vérité […] je t’aimerai Seigneur […] j’aimerai ici, ô mon Dieu, et j’espérerai toujours en ta miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges […] O Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants ». [15]
C’est ainsi qu’il le nota dans son carnet, en retrouvant la paix. Et cette expérience, avec ses inquiétudes et ses questions, restera toujours éclairante pour lui et lui donnera une façon unique d’accéder au mystère de la relation entre Dieu et l’homme. Elle l’aidera à écouter la vie des autres et à reconnaître, avec un fin discernement, l’attitude intérieure qui unit la pensée au sentiment, la raison à l’affection, et qu’il dénommera le “Dieu du cœur humain”. De cette manière, François n’a pas couru le risque de faire de son expérience personnelle une valeur théorique, en l’absolutisant, mais il a appris une chose extraordinaire, fruit de la grâce : lire en Dieu sa propre expérience et celle des autres.
Bien qu’il n’ait jamais prétendu élaborer un véritable système théologique, sa réflexion sur la vie spirituelle a une éminente valeur théologique. Apparaissent chez lui les caractéristiques essentielles de l’exercice de la théologie dont deux dimensions constitutives ne doivent jamais être oubliées. La première est la vie spirituelle, précisément, car c’est dans la prière humble et persévérante, dans l’ouverture à l’Esprit Saint que l’on peut chercher à comprendre et à exprimer le Verbe de Dieu. On devient théologien dans le creuset de la prière. La deuxième dimension est la vie ecclésiale : sentir dans l’Église et avec l’Église. La théologie a souffert également de la culture individualiste, mais le théologien chrétien élabore sa pensée en étant immergé dans la communauté, en y rompant le pain de la Parole. [16] La réflexion de François de Sales, en marge des disputes d’écoles de son temps, tout en les respectant, découle précisément de ces deux traits constitutifs.
La découverte d’un monde nouveau
Une fois terminées ses humanités, il poursuivit des études de droit à l’Université de Padoue. Rentré à Annecy, il décida de l’orientation de sa vie, malgré les résistances paternelles. Ordonné prêtre le 18 décembre 1593, il fut, dans les premiers jours de septembre de l’année suivante, appelé par l’évêque, Mgr Claude de Granier, à la difficile mission du Chablais. C’était un territoire du diocèse d’Annecy, de confession calviniste, qui, dans le dédale complexe des guerres et des traités de paix, était de nouveau passé sous le contrôle du duché de Savoie. Ce furent des années intenses et dramatiques. Il y découvrit ses talents de médiateur et d’homme de dialogue, mais aussi certaines intransigeances rigides qui lui donneront plus tard matière à réflexion. Il se montra aussi l’inventeur de pratiques pastorales originales et audacieuses, comme les fameuses “feuilles volantes”, placardées un peu partout et même glissées sous les portes des maisons.
En 1602, il retourna à Paris pour une délicate mission diplomatique au nom du même Mgr de Granier et selon les indications précises du Siège apostolique, à la suite d’une énième évolution du cadre politique et religieux du diocèse de Genève. Malgré les bonnes dispositions du Roi de France, la mission échoua. Il écrivit lui-même au Pape Clément VIII : « Après neuf mois entiers, j’ai été contraint de m’en retourner sans avoir presque rien fait ». [17] Pourtant, cette mission se révéla être pour lui et pour l’Église d’une richesse inattendue sur le plan humain, culturel et religieux. Pendant le temps libre accordé par les négociations diplomatiques, François prêcha en présence du Roi et de la cour de France, noua d’importantes relations et, surtout, s’immergea totalement dans le prodigieux printemps spirituel et culturel de la moderne capitale du royaume.
Là, tout avait changé ou était en train de changer. Lui-même se laissa toucher et interroger par les grands problèmes du monde et la nouvelle façon de les considérer, par la surprenante demande de spiritualité qui était née et les questions inédites qu’elle posait. En bref, il prit conscience d’un véritable “changement d’époque” auquel il convenait de répondre par des formes anciennes et nouvelles de langage. Ce n’était certes pas la première fois qu’il rencontrait des chrétiens fervents, mais il s’agissait de quelque chose de différent. Ce n’était plus le Paris ravagé par les guerres de religion qu’il avait vu dans ses années de formation, ni la lutte acharnée soutenue dans les territoires du Chablais. C’était une réalité inattendue : une foule « de saints, de vrais saints, nombreux et partout ». [18] C’étaient des hommes et des femmes de culture, des professeurs de Sorbonne, des représentants des institutions, des princes et princesses, des serviteurs et des servantes, des religieux et religieuses. Un monde si diversement assoiffé de Dieu.
Rencontrer ces personnes et connaître leurs questions fut l’une des circonstances providentielles les plus importantes de sa vie. Des jours apparemment inutiles et creux se transformèrent ainsi en une école incomparable, pour lire, sans jamais les édulcorer, les humeurs de son temps. En lui, l’habile et inlassable polémiste se transformait, par grâce, en un fin interprète de son époque et un extraordinaire directeur d’âmes. Son action pastorale, ses grandes œuvres (l’Introduction à la vie dévote et le Traité de l’amour de Dieu), les milliers de lettres d’amitié spirituelle qui seront envoyées, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs des couvents et des monastères, aux religieux et aux moniales, aux hommes et aux femmes de la cour comme aux gens ordinaires, la rencontre avec Jeanne Françoise de Chantal et la fondation même de la Visitation en 1610, seraient incompréhensibles sans ce retournement intérieur. L’Évangile et la culture formaient alors une féconde synthèse d’où découlait l’intuition d’une méthode juste et originale, arrivée à maturité et prête à porter un fruit durable et plein de promesses.
Dans l’une des toutes premières lettres de direction et d’amitié spirituelle, envoyée à l’une des communautés visitées à Paris, François de Sales parle, bien qu’en toute humilité, de “sa méthode” qui se différencie des autres, en vue d’une vraie réforme. Une méthode qui renonce à la sévérité et qui compte pleinement sur la dignité et la capacité d’une âme pieuse, malgré ses faiblesses : « Je me doute encore qu’il y ait un autre empêchement à votre réformation : c’est qu’à l’aventure, ceux qui vous l’ont proposée ont manié la plaie un peu âprement […] Je loue leur méthode, bien que ce ne soit pas la mienne, surtout à l’endroit des esprits nobles et bien éduqués comme sont les vôtres ; je crois qu’il est mieux de leur montrer simplement le mal, et leur mettre le fer en main afin qu’ils fassent eux-mêmes l’incision. Néanmoins, ne vous laissez pas pour cela de vous réformer ». [19] Dans ces phrases transparaît ce regard qui a rendu célèbre l’optimisme salésien et qui a laissé son empreinte durable dans l’histoire de la spiritualité permettant des floraisons successives, comme dans le cas de don Bosco deux siècles plus tard.
Rentré à Annecy, il fut ordonné évêque le 8 décembre de la même année 1602. L’influence de son ministère épiscopal sur l’Europe de l’époque et des siècles suivants apparaît immense. « C’est un apôtre, un prédicateur, un homme d’action et de prière ; engagé dans la réalisation des idéaux du Concile de Trente ; participant à la controverse et au dialogue avec les protestants, faisant toujours plus l’expérience, au-delà de la confrontation théologique nécessaire, de l’importance de la relation personnelle et de la charité ; chargé de missions diplomatiques au niveau européen, et de fonctions sociales de médiation et de réconciliation ». [20] Il est surtout un interprète privilégié d’un changement d’époque et le guide des âmes en un temps qui, d’une manière nouvelle, a soif de Dieu.
La charité fait tout pour ses enfants
Entre 1620 et 1621, François, désormais proche de la fin de sa vie, adressait à un prêtre de son diocèse des mots qui éclairent sa vision de l’époque. Il l’encourageait à suivre son désir de se consacrer à la rédaction de textes originaux, capables de prendre en compte les nouvelles interrogations, en ayant conscience de leur nécessité. « Je dois vous dire que la connaissance que je prends tous les jours des humeurs du monde me fait souhaiter passionnément que la divine Bonté inspire quelques-uns de ses serviteurs d’écrire au goût de ce pauvre monde ». [21] La raison de cet encouragement, il la trouvait dans sa vision du temps : « Le monde devient si délicat, que désormais on ne l’osera toucher qu’avec des gants musqués, ni panser ses plaies qu’avec des emplâtres de civette ; mais qu’importe, pourvu que les hommes soient guéris et qu’en fin ils soient sauvés ? Notre reine, la charité, fait tout pour ses enfants ». [22] Ce n’était pas gagné d’avance, encore moins une reddition définitive face à la défaite. C’était plutôt l’intuition d’un changement en acte et de l’exigence, toute évangélique, de comprendre comment pouvoir l’habiter.
Il avait d’ailleurs mûri la même conscience et l’avait exprimée dans la Préface du Traité de l’amour de Dieu : « J’ai eu en considération la condition des esprits de ce siècle, et je le devais : il importe beaucoup de regarder en quel âge on écrit ». [23] En demandant ensuite la bienveillance du lecteur, il affirmait : « Si tu trouves le style un […] peu différent de celui dont j’ai usé écrivant à Philothée, et tous deux grandement divers de celui que j’ai employé en la Défense de la Croix, sache qu’en dix-neuf ans, on apprend et désapprend beaucoup de choses ; que le langage de la guerre est autre que celui de la paix, et que l’on parle d’une façon aux jeunes apprentis, et d’une autre sorte aux vieux compagnons ». [24] Mais, face à ce changement, par où commencer ? Par l’histoire même de Dieu avec l’homme. D’où le dernier objectif de son Traité : « Certes, j’ai seulement pensé à représenter simplement et naïvement, sans art et encore plus sans fard, l’histoire de la naissance, du progrès, de la décadence des opérations, propriétés, avantages et excellences de l’amour divin ». [25]
Les questions d’un passage d’époque
À l’occasion du quatrième centenaire de sa mort, je me suis interrogé sur l’héritage de saint François de Sales pour notre époque, et j’ai trouvé éclairantes sa souplesse et sa capacité de vision. Par un don de Dieu d’une part, par sa nature personnelle d’autre part, et aussi par sa solide expérience, il avait eu la nette perception d’un changement d’époque. Lui-même n’aurait jamais imaginé y reconnaître une telle opportunité pour l’annonce de l’Évangile. La Parole qu’il avait aimée depuis sa jeunesse était capable de faire son chemin, ouvrant des horizons nouveaux et imprévisibles, dans un monde en transition rapide.
C’est ce qui nous attend aussi comme tâche essentielle pour le changement d’époque que nous vivons : une Église non autoréférentielle, libre de toute mondanité mais capable d’habiter le monde, de partager la vie des personnes, de marcher ensemble, d’écouter et d’accueillir. [26] C’est ce que François de Sales a accompli en déchiffrant son époque, avec l’aide de la grâce. C’est pourquoi il nous invite à sortir d’une préoccupation excessive de nous-mêmes, des structures, de l’image que nous donnons dans la société et à nous demander plutôt quels sont les besoins concrets et les attentes spirituelles de notre peuple. [27] Il est donc important, aujourd’hui encore, de relire certains de ses choix cruciaux, pour habiter le changement avec une sagesse évangélique.
La brise et les ailes
Le premier de ces choix a été de relire et de proposer de nouveau, à chacun dans sa condition particulière, la relation heureuse entre Dieu et l’être humain. Au fond, la raison ultime et le but concret du Traité est précisément de montrer aux contemporains l’attraction de l’amour de Dieu. « Quels sont – se demande-t-il – les cordages ordinaires par lesquels la divine Providence a accoutumé de tirer nos cœurs à son amour ? ». [28] Prenant de manière suggestive comme point de départ le texte d’Osée 11, 4, [29] il définit ces moyens ordinaires comme des « liens d’humanité ou de charité et d’amitié ». « Sans doute – écrit-il – [que] nous ne sommes pas tirés à Dieu par des liens de fer, comme les taureaux et les buffles, mais par manière d’allèchements, d’attraits délicieux et de saintes inspirations, qui sont en somme les liens d’Adam et d’humanité ; c’est-à-dire proportionnés et convenables au cœur humain, auquel la liberté est naturelle ». [30] C’est par ces liens que Dieu a tiré son peuple de l’esclavage, en lui apprenant à marcher, en le tenant par la main, comme le fait un papa ou une maman avec son enfant. Aucune imposition extérieure, donc, aucune force despotique et arbitraire, aucune violence. Plutôt, la forme persuasive d’une invitation qui laisse intacte la liberté de l’homme. « La grâce – poursuit-il en pensant certainement à tant d’histoires de vie rencontrées – a des forces, non pour forcer, mais pour allécher le cœur ; elle a une sainte violence, non pour violer, mais pour rendre amoureuse notre liberté ; elle agit fortement, mais si suavement que notre volonté ne demeure point accablée sous une si puissante action ; elle nous presse, mais elle n’oppresse pas notre franchise : si bien que nous pouvons, emmi ses forces, consentir ou résister à ses mouvements selon qu’il nous plaît ». [31]
Peu avant, il avait illustré cette relation avec l’exemple curieux de l’« apode » : « Il y a certains oiseaux, Théotime, qu’Aristote nomme “apodes”, parce qu’ayant les jambes extrêmement courtes, et les pieds sans force, ils ne s’en servent non plus que s’ils n’en avaient point : que si une fois ils prennent terre, ils y demeurent pris, sans que jamais d’eux-mêmes ils puissent reprendre le vol, d’autant que n’ayant nul usage des jambes ni des pieds, ils n’ont pas non plus le moyen de se pousser et relancer en l’air ; et partant, ils demeurent là croupissants et y meurent, sinon que quelque vent propice à leur impuissance, jetant ses bouffées sur la face de la terre, les vienne saisir et enlever, comme il fait plusieurs autres choses ; car alors, si employant leurs ailes ils correspondent à cet élan et premier essor que le vent leur donne, le même vent continue aussi son secours envers eux, les poussant de plus en plus au vol ». [32] L’homme est ainsi : fait par Dieu pour voler et déployer toutes ses potentialités dans l’appel à l’amour, il risque de devenir incapable de décoller quand il tombe à terre et n’accepte pas de rouvrir les ailes au souffle de l’Esprit.
Voilà donc la « forme » par laquelle la grâce de Dieu se donne aux hommes : celle des liens précieux et si humains d’Adam. La force de Dieu ne cesse jamais d’être absolument capable de faire prendre son envol et, néanmoins, sa douceur fait en sorte que la liberté d’y consentir n’est ni violée ni inutile. Il revient à l’homme de se lever ou de ne pas se lever. Bien que la grâce l’ait touché au réveil, sans lui, elle ne veut pas que l’homme se lève sans y consentir. Ainsi tire-t-il sa réflexion finale : « Théotime, les inspirations nous préviennent, et avant que nous y ayons pensé elles se font sentir, mais après que nous les ayons senties, c’est à nous d’y consentir pour les seconder et suivre leurs attraits, ou de le dissentir et les repousser : elles se font sentir à nous, sans nous, mais elles ne nous font pas consentir sans nous ». [33] Par conséquent, dans la relation avec Dieu, il s’agit toujours d’une expérience de gratuité qui témoigne de la profondeur de l’amour du Père.
Cependant, cette grâce ne rend jamais l’homme passif. Elle nous fait comprendre que nous sommes radicalement précédés par l’amour de Dieu, et que son premier don consiste précisément à se recevoir de son amour. Chacun, cependant, a le devoir de coopérer à sa propre réalisation, en déployant avec confiance ses ailes au souffle de Dieu. Nous voyons ici un aspect important de notre vocation humaine : « Le devoir que Dieu confie à Adam et Eve dans le récit de la Genèse est d’être féconds. L’humanité s’est vue confier la tâche de changer, de construire et de dominer la création, une tâche positive qui consiste à créer à partir d’elle et avec elle. L’avenir ne dépend donc pas d’un mécanisme invisible dont les êtres humains sont des spectateurs passifs. Non, nous sommes des protagonistes, nous sommes – en forçant le mot – co-créateurs ». [34] C’est ce que François de Sales a bien compris et a essayé de transmettre dans son ministère de guide spirituel.
La vraie dévotion
Un deuxième grand choix crucial a été celui d’aborder la question de la dévotion. Comme de nos jours, là encore, la nouvelle époque avait soulevé un bon nombre d’interrogations. En particulier, deux aspects demandent à être, aujourd’hui encore, compris et relancés. Le premier concerne l’idée même de dévotion, le second, son caractère universel et populaire. Indiquer ce que l’on entend par dévotion, c’est le premier point qui est abordé au début de Philothée : « Il faut avant toutes choses que vous sachiez ce qu’est la vertu de dévotion ; car, d’autant qu’il n’y en a qu’une vraie, et qu’il y en a une grande quantité de fausses et vaines, si vous ne connaissiez quelle est la vraie, vous pourriez vous tromper et vous amuser à suivre quelque dévotion impertinente et superstitieuse ». [35]
La description de la fausse dévotion par François de Sales est savoureuse et toujours actuelle et il n’est pas difficile pour nous de nous y retrouver, non sans une touche efficace de sain humour : « Celui qui est adonné au jeûne se tiendra pour bien dévot pourvu qu’il jeûne, quoi que son cœur soit plein de rancune ; et n’osant point tremper sa langue dans le vin ni même dans l’eau, par sobriété, ne se feindra point de la plonger dedans le sang du prochain par la médisance et calomnie. Un autre s’estimera dévot parce qu’il dit une grande multitude d’oraisons tous les jours, quoi qu’après cela sa langue se fonde toute en paroles fâcheuses, arrogantes et injurieuses parmi ses domestiques et voisins. L’autre tire fort volontiers l’aumône de sa bourse pour la donner aux pauvres, mais il ne peut tirer la douceur de son cœur pour pardonner à ses ennemis ; l’autre pardonnera à ses ennemis, mais de tenir raison à ses créanciers, jamais qu’à vive force de justice ». [36] Ce sont des vices et des efforts de tous les temps, même d’aujourd’hui, pour lesquels le Saint conclut : « Tous ces gens-là sont vulgairement tenus pour dévots, et ne le sont pourtant nullement ». [37]
La nouveauté et la vérité de la dévotion se trouvent ailleurs, profondément enracinées dans la vie divine en nous. De cette manière « la vraie et vivante dévotion […] présuppose l’amour de Dieu, ainsi elle n’est autre chose qu’un vrai amour de Dieu, mais non pas toutefois un amour tel quel ». [38] Dans son imagination fervente, elle n’est « autre chose qu’une agilité et vivacité spirituelle par le moyen de laquelle la charité fait ses actions en nous, ou nous par elle, promptement et affectionnément ». [39] Ainsi, elle n’est pas placée à côté de la charité, mais en est une manifestation et, en même temps, y conduit. C’est comme une flamme par rapport au feu : elle ravive son intensité, sans en changer la qualité. « Enfin, la charité et la dévotion ne sont non plus différentes l’une de l’autre que la flamme l’est du feu, d’autant que la charité étant un feu spirituel, quand elle est fort enflammée elle s’appelle dévotion : si que la dévotion n’ajoute rien au feu de la charité, sinon la flamme qui rend la charité prompte, active et diligente, non seulement à l’observation des commandements de Dieu, mais à l’exercice des conseils et inspirations célestes ». [40] Une dévotion ainsi comprise n’a rien d’abstrait. Elle est plutôt un style de vie, une façon d’être dans le concret de l’existence quotidienne. Elle rassemble et donne un sens aux petites choses de tous les jours, la nourriture et les vêtements, le travail et les loisirs, l’amour et la fécondité, l’attention aux obligations professionnelles. Bref, elle éclaire la vocation de chacun.
On devine ici la racine populaire de la dévotion, affirmée dès les premières paroles de Philothée : « Ceux qui ont traité de la dévotion ont presque tous regardé l’instruction des personnes fort retirées du commerce du monde, ou au moins ont enseigné une sorte de dévotion qui conduit à cette entière retraite. Mon intention est d’instruire ceux qui vivent en villes, en ménages, dans la cour, et qui par leur condition sont obligés de faire une vie commune ». [41] C’est pourquoi celui qui pense reléguer la dévotion à quelque domaine protégé et réservé se trompe lourdement. Au contraire, elle appartient à tous et est pour tous, où que nous soyons, et chacun peut la pratiquer selon sa vocation. Comme l’écrivait saint Paul VI à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de François de Sales, « la sainteté n’est pas l’apanage de l’une ou de l’autre classe ; mais l’invitation pressante est adressée à tous les chrétiens : “Mon ami, monte plus haut” ( Lc 14, 10) ; tous sont liés par l’obligation de gravir la montagne de Dieu, même si tous ne suivent pas le même chemin. “La dévotion doit être exercée différemment par le gentilhomme, l’artisan, le servant, le prince, la veuve, la jeune femme, la mariée. Plus encore, la pratique de la dévotion doit être adaptée aux forces, aux affaires et aux devoirs de chacun” ». [42] Traverser la cité terrestre en préservant l’intériorité, allier le désir de perfection à chaque état de vie, en retrouvant un centre qui ne se sépare pas du monde mais apprend à l’habiter, à l’apprécier, en apprenant aussi à prendre ses distances. Telle était son intention, et cela continue d’être une leçon précieuse pour chaque homme et chaque femme de notre temps.
C’est le thème conciliaire de la vocation universelle à la sainteté : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père ». [43] “Chacun dans sa route”. « Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles ». [44] La Mère Église nous les propose non pas pour que nous cherchions à les imiter, mais pour qu’ils nous poussent à marcher sur le chemin unique et spécifique que le Seigneur a pensé pour nous. « Ce qui compte, c’est que chaque croyant discerne son chemin et fasse ressortir le meilleur de lui-même, ce que Dieu a placé en lui de manière si personnelle (cf. 1 Co 12, 7) ». [45]
L’extase de la vie
Tout cela a conduit le saint évêque à considérer la vie chrétienne dans son ensemble comme « l’extase de l’œuvre et de la vie ». [46] Celle-ci ne doit cependant pas être confondue avec une fuite facile ou un retrait dans l’intimité, et encore moins avec une obéissance triste et grise. Nous savons que ce danger est toujours présent dans la vie de foi. En effet, « il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. […] Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis ». [47]
Permettre à la joie de s’éveiller est précisément ce que François de Sales exprime en décrivant « l’extase de l’œuvre et de la vie ». Grâce à elle, « nous vivons non seulement une vie civile, honnête et chrétienne, mais une vie surhumaine, spirituelle, dévote et extatique, c’est-à-dire une vie qui est de toute façon en dehors et au-dessus de notre condition naturelle ». [48] Nous nous trouvons ici dans les pages centrales et les plus lumineuses du Traité. L’extase est l’heureuse surabondance de la vie chrétienne, élevée bien au-dessus de la médiocrité de la simple observance : « Ne point dérober, ne point mentir, ne point commettre de luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain, aimer et honorer son père, ne point tuer, c’est vivre selon la raison naturelle de l’homme. Mais quitter tous nos biens, aimer la pauvreté, l’appeler et tenir en qualité de très délicieuse maîtresse ; tenir les opprobres, mépris, abjections, persécutions, martyres, pour des félicités et béatitudes; se contenir dans les termes d’une absolue chasteté, et enfin vivre parmi le monde et en cette vie mortelle contre toutes les opinions et maximes du monde, et contre le courant du fleuve de cette vie par des ordinaires résignations, renoncements et abnégations de nous-mêmes, ce n’est pas vivre humainement, mais surhumainement; ce n’est pas vivre en nous, mais hors de nous et au-dessus de nous. Et parce que nul ne peut sortir en cette façon au-dessus de soi-même, si le Père éternel ne le tire, partant cette sorte de vie doit être un ravissement continuel et une extase perpétuelle d’action et d’opération ». [49]
C’est une vie qui a retrouvé les sources de la joie, contre toute aridité, contre la tentation du repli sur soi. En effet, « le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie ». [50]
À la description de « l’extase de l’œuvre et de la vie », saint François ajoute, enfin, deux précisions importantes, également pour notre temps. La première concerne un critère efficace pour discerner la vérité de ce mode de vie. La seconde concerne la source profonde de celui-ci. En ce qui concerne le critère de discernement, il précise que, si cette extase implique une véritable sortie de soi, elle ne signifie pas pour autant un abandon de la vie. Il est important de ne jamais l’oublier, pour éviter de dangereuses déviations. En d’autres termes, celui qui prétend s’élever vers Dieu, mais ne vit pas la charité envers son prochain, se trompe lui-même et trompe les autres.
Nous retrouvons ici le même critère qu’il appliquait à la qualité de la vraie dévotion. « Quand on voit une personne qui en l’oraison a des ravissements par lesquels elle sort et monte au-dessus de soi-même en Dieu, et néanmoins n’a point d’extase en sa vie, c’est-à-dire ne fait point une vie relevée et attachée à Dieu, […] surtout par une continuelle charité, croyez, Théotime, que tous ses ravissements sont grandement douteux et périlleux ». Sa conclusion est très efficace : « Être au-dessus de soi-même en l’oraison et au-dessous de soi en la vie et opération, être angélique en la méditation et bestial en la conversation […] est une vraie marque que tels ravissements et telles extases ne sont que des amusements et des tromperies du malin esprit ». [51] C’est, en substance, ce que Paul rappelait déjà aux Corinthiens dans l’hymne à la charité : « J’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (1 Co 13, 2-3).
Pour saint François de Sales, donc, la vie chrétienne n’est jamais sans extase et, cependant, l’extase n’est pas authentique sans la vie. En effet, la vie sans extase risque d’être réduite à une obéissance opaque, à un Évangile qui a oublié sa joie. Par contre, l’extase sans la vie s’expose facilement à l’illusion et à la tromperie du malin. Les grandes polarités de la vie chrétienne ne peuvent être résolues l’une dans l’autre. Au contraire, l’une maintient l’autre dans son authenticité. Ainsi, la vérité ne va pas sans la justice, la complaisance sans la responsabilité, la spontanéité sans la loi, et vice versa.
Quant à la source profonde de cette extase, il la relie judicieusement à l’amour manifesté par le Fils incarné. S’il est vrai, d’une part, que « l’amour est le premier acte et principe de notre vie dévote ou spirituelle, par lequel nous vivons, sentons et nous émouvons » et, d’autre part, que « notre vie spirituelle est telle que sont nos mouvements affectifs », il est clair qu’ « un cœur qui n’a point de mouvement et d’affection, n’a point d’amour », de même qu’ « un cœur qui a de l’amour n’est point sans mouvement affectif ». [52] Mais la source de cet amour qui attire le cœur est la vie de Jésus-Christ : « Rien ne presse tant le cœur de l’homme que l’amour », et le point culminant de cette pression est le fait que « Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a donné la vie par sa mort ; nous ne vivons que parce qu’il est mort, il est mort pour nous, à nous et en nous ». [53]
Cette indication est émouvante, parce qu’elle révèle non seulement une vision éclairée et non évidente du rapport entre Dieu et l’homme, mais aussi le lien affectif étroit qui liait le saint évêque au Seigneur Jésus. La vérité de l’extase de la vie et de l’action n’est pas n’importe laquelle, mais c’est celle qui apparaît sous la forme de la charité du Christ, qui culmine sur la croix. Cet amour n’annule pas l’existence, mais la fait briller d’une qualité extraordinaire.
C’est pour cette raison que saint François de Sales utilise une très belle image pour décrire le Calvaire comme « le mont des amants ». [54] Là, et seulement là, on comprend qu’ « on ne peut avoir la vie sans l’amour, ni l’amour sans la mort du Rédempteur. Mais hors de là, tout est ou mort éternelle ou amour éternel, et toute la sagesse chrétienne consiste à bien choisir ». [55] Ainsi, il peut clore son Traité en renvoyant à la conclusion d’un discours de saint Augustin sur la charité : « Qu’y a-t-il de plus fidèle que la charité ? Fidèle non pas à l’éphémère mais à l’éternel. Elle supporte tout dans la vie présente, pour la raison qu’elle croit tout sur la vie future : elle supporte tout ce qui nous est donné à supporter ici, parce qu’elle espère tout ce qui lui est promis là-bas. A juste titre, elle n’a jamais de fin. Pratiquez donc la charité et portez, en la méditant saintement, les fruits de la justice. Et si vous trouvez d’autres choses à sa louange que je ne vous ai pas dites maintenant, que cela se voie dans votre manière de vivre ». [56]
Voilà ce qui ressort de la vie du saint évêque d’Annecy, et qui est livré, une fois encore, à chacun de nous. Que le quatrième Centenaire de sa naissance au Ciel nous aide à en faire une mémoire pieuse et que, par son intercession, le Seigneur déverse les dons de l’Esprit en abondance sur le chemin du peuple fidèle de Dieu.
Rome, Saint-Jean-du-Latran, 28 décembre 2022
FRANÇOIS
Notes :
[1] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 336.
[2] Id., Lettre 2103 :À Monsieur Sylvestre de Saluces de la Mente, Abbé d’Hautecombe (3 nov. 1622), in Œuvres de Saint François de Sales, Tome XXVI, Annecy 1918, pp. 490-491.
[3] Id., Lettre DCCCXXVIII : À une Dame (19 déc. 1622), in Œuvres Complètes de Saint François de Sales, Évêque et Prince de Genève, Tome III, Paris 1861, p. 659.
[4] Id., Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 395.
[5] Id., Entretiens spirituels, Dernier entretien [21], in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 1319.
[6] Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 mars 2018), n. 49 : AAS 110 (2018), p. 1124.
[7] Ibid., n. 57 : AAS 110 (2018), p. 1127.
[8] Cf. Ibid., nn. 37-39 : AAS 110 (2018), p. 1121-1122.
[9] S. François de Sales, Entretiens spirituels, Dernier entretien [21], in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 1319.
[10] Ibid., p. 1308.
[11] Ibid.
[12] Lettre à l’Évêque d’Annecy (France) à l’occasion du 4ème Centenaire de l’Ordination épiscopale de saint François de Sales (23 novembre 2002), n. 3 : Enseignements de Jean-Paul II, XXV/2 (2022), p. 767.
[13] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 336.
[14] Benoît XVI, Catéchèse, 2 mars 2011 : Enseignements, VII/1 (2011), p. 270.
[15] S. François de Sales, Fragments d’écrits intimes, 3 : Acte d’abandon héroïque, in Œuvres de saint François de Sales, tome XXII (Opuscules, I), Annecy 1925, p. 41.
[16] Cf. Discours à la Commission Théologique Internationale, 29 novembre 2019 : L’Osservatore Romano, 30 novembre 2019, p. 8.
[17] S. François de Sales, Lettre 165 : À Sa Sainteté Clément VIII (fin octobre 1602), in Œuvres de saint François de Sales, Tome XII ( Lettres, II : 1599-1604), Annecy 1902, p. 128.
[18] H. Bremond, L’humanisme dévot : 1580-1660, in Histoire littéraire du sentiment religieux en France : depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, Tome I, Jérôme Millon, Grenoble, 2006, p. 131.
[19] S. François de Sales, Lettre 168 Aux religieuses du monastère des « Filles-Dieu » (22 novembre 1602), in Œuvres de Saint François de Sales, Tome XII ( Lettres, II : 1599-1604), Annecy 1902, 105.
[20] Benoît XVI, Catéchèse, 2 mars 2011 : Enseignements, VII/1 (2011), p. 272.
[21] S. François de Sales, Lettre 1869 : À Monsieur Pierre Jay, (1620 ou 1621), in Œuvres de saint François de Sales, Tome XX ( Lettres, X : 1621-1622), Annecy 1918, p. 219.
[22] Ibid.
[23] Id., Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 339.
[24] Ibid., p. 347
[25] Ibid., pp. 338-339.
[26] Cf. Discours aux évêques, prêtres, religieux et religieuses, séminaristes et catéchistes, Bratislava, 13 septembre 2021 : L’Osservatore Romano, 13 septembre 2021, pp. 11-12.
[27] Cf. Ibid.
[28] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 444.
[29] « Je les menais avec des attaches humaines [Vulg : in funiculis Adam], avec des liens d’amour ; j’étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je m’inclinais vers lui et le faisais manger ».
[30] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 444.
[31] Ibid., pp. 444-445.
[32] Ibid., p. 434.
[33] Ibid., p. 446.
[34] Ritorniamo a sognare. La strada per un futuro migliore, Conversazione con Austen Ivereigh, Piemme, Milano 2020, p. 8.
[35] S. François de Sales, Philothée. Introduction à la vie dévote, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 31.
[36] Ibid., pp. 31-32.
[37] Ibid., p.32.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Ibid., p. 33.
[41] Ibid., p 23.
[42] Lett. ap. Sabaudiae gemma à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de saint François de Sales Docteur de l’Eglise (29 janvier 1967) : AAS 59 (1967), p. 119.
[43] Conc. Œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 11.
[44] Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 11 : AAS 110 (2018), p. 1114.
[45] Ibid.
[46] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 682.
[47] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 6 : AAS 105 (2013), pp. 1021-1022.
[48] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, pp. 682-683.
[49] Ibid., p. 683.
[50] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 2: AAS 105 (2013), pp. 1019-1020.
[51] S. François de Sales, Traité de l’Amour de Dieu, in Œuvres, éd. André Ravier, Gallimard, Paris 1969, p. 685.
[52] Ibid., p. 684.
[53] Ibid., pp. 687-688.
[54] Ibid., p. 971.
[55] Ibid.
[56] Discours, 350, 3 : PL 39, p. 1535.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
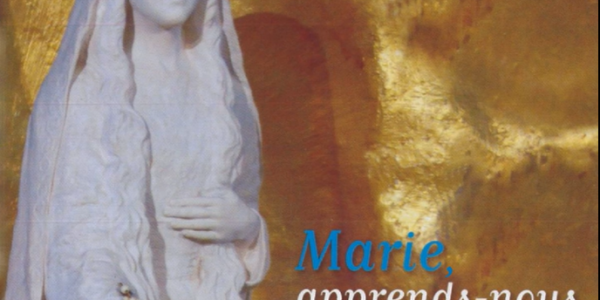
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenu à tous !
La semaine dernière, j’ai visité deux pays africains : la République Démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Je remercie Dieu qui m’a permis de faire ce voyage tant désiré. Deux « rêves » : rendre visite aux Congolais, gardiens d’un pays immense, poumon vert de l’Afrique : avec l’Amazonie ce sont les deux du monde. Une terre riche en ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite au peuple sud-soudanais, dans un pèlerinage de paix ensemble avec l’archevêque de Canterbury Justin Welby et le modérateur général de l’Église d’Écosse, Iain Greenshields : nous sommes allés ensemble pour témoigner qu’il est possible et impératif de collaborer dans la diversité, surtout si l’on partage la foi en Jésus Christ.
Les trois premiers jours, j’étais à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. Je renouvelle ma gratitude au Président et aux autres Autorités du pays pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. Immédiatement après mon arrivée, au Palais présidentiel, j’ai pu adresser un message à la Nation : le Congo est comme un diamant, de par sa nature, ses ressources, et surtout son peuple ; mais ce diamant est devenu une source de discorde, de violence, et paradoxalement d’appauvrissement du peuple. C’est une dynamique que l’on retrouve également dans d’autres régions d’Afrique, et qui s’applique à ce continent en général : un continent colonisé, exploité, pillé. Face à tout cela, j’ai dit deux paroles : la première est négative : » ça suffit ! « , arrêtez d’exploiter l’Afrique ! J’ai déjà dit d’autres fois que dans l’inconscient collectif, c’est comme inscrit « l’Afrique doit être exploitée » : ça suffit ! Je l’ai dit. La seconde est positive : ensemble, ensemble avec dignité, tous ensemble avec respect mutuel, ensemble au nom du Christ, notre espérance, aller de l’avant. Ne pas exploiter et aller de l’avant ensemble.
Et au nom du Christ, nous nous sommes réunis dans la grande Célébration eucharistique.
Toujours à Kinshasa se sont déroulées différentes rencontres : celle avec les victimes de la violence de l’est du pays, la région qui depuis des années est déchirée par la guerre entre groupes armés manœuvrés par des intérêts économiques et politiques. Je n’ai pas pu me rendre à Goma. Les gens vivent dans la peur et l’insécurité, sacrifiés sur l’autel des affaires illicites. J’ai écouté les témoignages bouleversants de certaines victimes, notamment des femmes, qui ont déposé au pied de la Croix des armes et autres instruments de mort. Avec eux, j’ai dit « non » à la violence, « non” à la résignation, « oui » à la réconciliation et à l’espérance. Ils ont déjà tellement souffert et continuent de souffrir.
J’ai rencontré ensuite les représentants de diverses œuvres caritatives du pays, pour les remercier et les encourager. Leur travail avec les pauvres et pour les pauvres ne fait pas de bruit, mais jour après jour, il fait croître le bien commun. Et surtout avec la promotion : les initiatives caritatives doivent toujours être avant tout destinées à la promotion, pas seulement pour l’assistance mais pour la promotion. Assistance oui, mais promotion.
Un moment enthousiasmant a été celui avec les jeunes et les catéchistes congolais au stade. C’était comme une immersion dans le présent projeté vers le futur. Pensons à la puissance de renouveau que peut apporter cette nouvelle génération de chrétiens, formée et animée par la joie de l’Évangile ! A eux, aux jeunes, j’ai indiqué cinq voies : la prière, la communauté, l’honnêteté, le pardon et le service. Aux jeunes du Congo, j’ai dit : voici votre chemin : prière, vie communautaire, honnêteté, pardon et service. Que le Seigneur entende leur cri en faveur de la paix et de la justice.
Ensuite, dans la cathédrale de Kinshasa j’ai rencontré les prêtres, les diacres, les hommes et femmes consacrés et les séminaristes. Ils sont nombreux et ils sont jeunes, car les vocations sont nombreuses : c’est une grâce de Dieu. Je les ai exhortés à être des serviteurs du peuple comme témoins de l’amour du Christ, en surmontant trois tentations : la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. Qui sont des tentations – je dirais – universelles, pour les séminaristes et pour les prêtres. Bien sûr, la médiocrité spirituelle, quand un prêtre tombe dans la médiocrité, cela est triste ; le confort mondain, c’est-à-dire la mondanité, qui est l’un des pires maux qui puissent arriver à l’Église ; et la superficialité. Enfin, avec les évêques congolais, j’ai partagé la joie et la fatigue du service pastoral. Je les ai invités à se laisser consoler par la proximité de Dieu et à être des prophètes pour le peuple, avec la force de la Parole de Dieu, être des signes de comment est le Seigneur, de l’attitude du Seigneur envers nous : la compassion, la proximité, la tendresse. Ce sont là trois manières dont le Seigneur agit avec nous : il s’approche – la proximité – avec compassion et avec tendresse. J’ai demandé cela aux prêtres et aux évêques.
Ensuite, la deuxième partie du voyage s’est déroulée à Juba, capitale du Soudan du Sud, un État né en 2011. Cette visite a revêtu un caractère très particulier, exprimé à travers la devise qui reprenait les paroles de Jésus : » Je prie pour que tous soient un » (cf. Jn 17, 21). Il s’agissait en effet d’un pèlerinage œcuménique de paix, effectué avec les chefs de deux Églises historiquement présentes dans ce pays : la Communion anglicane et l’Église d’Écosse. C’était l’aboutissement d’un parcours initié il y a quelques années, qui nous avait vu nous réunir à Rome en 2019, avec les autorités sud-soudanaises, pour nous engager à surmonter le conflit et construire la paix. En 2019, une retraite spirituelle de deux jours a été organisée ici, à la Curie, avec tous ces politiciens, avec toutes ces personnes aspirant à des postes, certains ennemis entre eux, mais ils étaient tous réunis dans cette retraite. Et cela a donné la force d’aller de l’avant. Malheureusement, le processus de réconciliation n’a pas beaucoup progressé et le Sud-Soudan à peine né est victime de la vieille logique de pouvoir, de rivalité, qui engendre guerre, violence, réfugiés et personnes déplacées internes. Je suis très reconnaissant à M. le Président pour l’accueil qu’il nous a réservé et pour la manière dont il essaie de gérer cette route pas facile, de dire « non » à la corruption et au trafic d’armes et « oui » à la rencontre et au dialogue. Et cela est honteux : tant de pays soi-disant civilisés offrent une aide au Sud-Soudan, et cette aide consiste en des armes, des armes, des armes pour fomenter la guerre. C’est une honte. Et oui, continuez à dire « non » à la corruption et au trafic d’armes et « oui » à la rencontre et au dialogue. Alors seulement, il peut y avoir du développement, les populations pourront travailler en paix, les malades se faire soigner, les enfants aller à l’école.
Le caractère œcuménique de la visite au Sud-Soudan était particulièrement évident lors du moment de prière célébré ensemble avec les frères et sœurs anglicans et ceux de l’Église d’Écosse. Ensemble, nous avons écouté la Parole de Dieu, ensemble nous avons adressé des prières de louange, de supplication et d’intercession. Dans une réalité hautement conflictuelle comme celle du Sud-Soudan, ce signe est fondamental, et il ne va pas de soi, car malheureusement, certains abusent du nom de Dieu pour justifier violence et abus.
Frères et sœurs, le Sud-Soudan est un pays d’environ 11 millions d’habitants – tout petit ! – dont, en raison des conflits armés, deux millions sont des déplacés internes et autant ont fui vers les pays voisins. C’est pourquoi j’ai voulu rencontrer un grand groupe de personnes déplacées internes, les écouter et leur faire sentir la proximité de l’Église. En effet, les Eglises et les organisations d’inspiration chrétienne sont en première ligne aux côtés de ces pauvres gens, qui vivent dans des camps de déplacés depuis des années. En particulier, je me suis tourné vers les femmes – il y a là des femmes de qualité – qui incarnent la force qui peut transformer le pays ; et j’ai encouragé tout le monde à être les semences d’un nouveau Sud-Soudan, sans violence, réconcilié et pacifié.
Puis, lors de la rencontre avec les Pasteurs et les personnes consacrées de cette Église locale, nous avons regardé Moïse comme un modèle de docilité à Dieu et de persévérance dans l’intercession.
Et au cours de la célébration eucharistique, ultime acte de la visite au Sud-Soudan et de tout le voyage, j’ai fait écho de l’Évangile en encourageant les chrétiens à être « sel et lumière » dans ce pays en proie à tant de tribulations. Dieu place son espérance non pas dans les grands et les puissants, mais dans les petits et les humbles. Et c’est la façon de faire de Dieu.
Je remercie les autorités du Sud-Soudan, M. le Président, les organisateurs du voyage et tous ceux qui ont fourni des efforts, du travail pour que la visite se déroule bien. Je remercie mes frères, Justin Welby et Iain Greenshields, de m’avoir accompagné dans ce voyage œcuménique.
Prions pour que, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, et dans toute l’Afrique, germent les semences de son Royaume d’amour, de justice et de paix.
Source : vatican.va
Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana